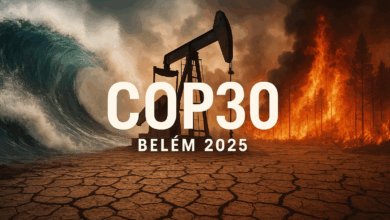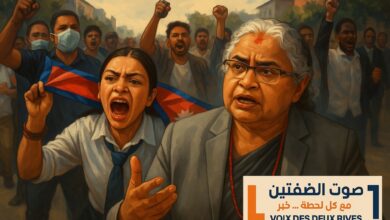ONU : Reconnaissance de la Palestine entre applaudissements et bulldozers
par L'écrivain et analyste politique Nizar Jlidi
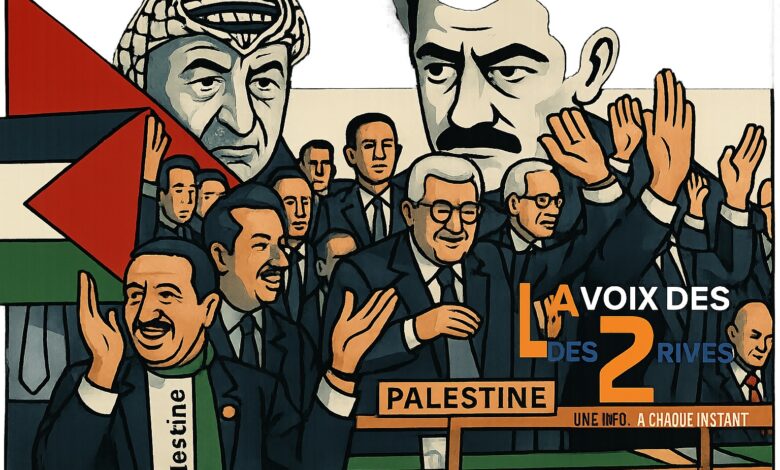
À New York, l’Assemblée générale a voté massivement pour endosser la « Déclaration de New York » sur la Palestine : 142 États pour, 10 contre, 12 abstentions. Derrière le consensus, une fracture nette : Washington et Tel-Aviv isolés face au reste du monde, tandis que Paris et Riyad s’érigent en promoteurs d’une solution à deux États. Mais entre communication diplomatique et hypocrisie régionale, l’épreuve de crédibilité se joue surtout en Europe.
Le 12 septembre 2025, l’Assemblée générale des Nations unies a donné son verdict : un raz-de-marée diplomatique en faveur de la reconnaissance d’un État palestinien. Cent quarante-deux pays ont approuvé la déclaration, dix s’y sont opposés, douze se sont abstenus. Les chiffres impressionnent, mais ils disent surtout l’isolement croissant des États-Unis et d’Israël, incapables de rallier au-delà de leur cercle le plus restreint de fidèles. Les images ont fait le tour du monde : d’un côté, les bancs pleins des pays arabes, africains, asiatiques et européens favorables à la Palestine ; de l’autre, la poignée de votes hostiles, Washington et Tel-Aviv en tête, qualifiant le texte de « cirque politique » et d’« acrobaties mal avisées ».
Pourtant, derrière la démonstration de force, une vérité persiste : le sort de la Palestine ne se joue pas dans les salles lambrissées de New York, mais dans les ruelles de Gaza, sur les collines de Cisjordanie, et dans les chancelleries où l’on signe ou non des décrets de reconnaissance.
Les Etats-Unis et Israël isolés face à un bloc 142 : l’épreuve de crédibilité européenne
L’opposition de Washington et Tel-Aviv à la déclaration a été immédiate, brutale. La mission américaine à l’ONU a dénoncé « encore une mise en scène malavisée et inopportune », une phrase calibrée pour délégitimer un processus mené hors de son contrôle. Israël, de son côté, a parlé d’un « cirque politique détaché de la réalité ». Quant à Benyamin Netanyahou, il n’a pas attendu le vote pour asséner sa ligne rouge : « Il n’y aura pas d’État palestinien », avait-il proclamé la veille à Maale Adumim, en marge de la signature du plan E1 qui prévoit plus de 3 400 nouvelles unités de colonisation en Cisjordanie. La séquence résume tout : l’Etat sioniste rejette la diplomatie tout en bétonnant le terrain.
Face à cette posture, la France et l’Arabie saoudite se sont posées en moteurs de l’initiative. En juillet, Paris et Riyad avaient copiloté la conférence qui a donné naissance au texte adopté par l’ONU, malgré le boycott américain et israélien. Pour Emmanuel Macron, le timing n’a rien d’innocent. Englué dans un second mandat marqué par les crises sociales, diplomatiques et sécuritaires, il a voulu marquer un geste fort : annoncer la reconnaissance de l’Etat palestinien dès septembre. Mais ce coup d’éclat tient plus du calcul politique que de l’élan sincère. La rue française, mobilisée depuis des mois contre les massacres de Gaza, impose sa pression. Le président français tente d’y répondre tout en conservant son alignement historique sur Washington. Les contradictions sautent aux yeux : à Paris, on proclame le droit des Palestiniens, tandis que sur le territoire national, on arrête encore des manifestants pour un keffieh ou un drapeau.
Du côté saoudien, le double langage est tout aussi manifeste. Officiellement, Riyad « salue l’adoption » de la déclaration et réaffirme son attachement à la solution à deux États. Officieusement, la normalisation avec Israël n’a jamais cessé. Sous l’impulsion de Mohammed ben Salmane, le royaume joue la carte d’un équilibre : offrir aux opinions arabes un discours favorable à la Palestine, tout en maintenant des passerelles avec Tel-Aviv et Washington. Dans cette logique, la solution à deux États devient un slogan commode : assez consensuel pour rassurer, assez vague pour ne pas engager. Mais la réalité du terrain – Gaza détruite, Cisjordanie rongée par les colonies – réduit cette promesse à une incantation.
Dans ce contexte, l’Europe est poussée dans ses retranchements. Le 11 septembre, la veille du vote à l’Assemblée générale de l’ONU, le Parlement européen a adopté une résolution appelant les États membres à envisager la reconnaissance de la Palestine. Le signal est clair : le consensus diplomatique international doit désormais se traduire en engagements concrets. Mais L’Allemagne, paralysée par son histoire et son alliance indéfectible avec la droite israélienne, reste figée. L’Italie se cale sur la ligne américaine tout en multipliant les exercices d’équilibriste. Le Royaume-Uni, lui, s’enferme dans une ambiguïté confortable. À Bruxelles, Paris, Madrid ou Dublin, les paroles existent déjà ; à Berlin et ailleurs, les silences pèsent davantage. L’isolement de Washington et Tel-Aviv met à nu une autre question : l’Europe peut-elle encore prétendre peser sur le conflit israélo-palestinien, ou restera-t-elle spectatrice d’une scène dominée par le suivisme américain et l’arrogance israélienne ?
La feuille de route sécuritaire : désarmement du Hamas, Autorité palestinienne et mission internationale
Le texte adopté par l’Assemblée générale ne se contente pas de proclamer l’horizon de deux États. Il précise des étapes censées transformer la promesse en processus concret. « Le Hamas doit cesser d’exercer son autorité sur la bande de Gaza et remettre ses armes à l’Autorité palestinienne, avec le soutien et la collaboration de la communauté internationale », stipule la déclaration. La formule est claire, solennelle, mais sa faisabilité reste douteuse. Car exiger le désarmement d’un mouvement qui, depuis des décennies, se définit par sa lutte armée contre Israël, revient à lui demander de renoncer à l’essence même de son existence politique et militaire.
L’objectif de cette clause est double : convaincre les chancelleries occidentales qu’un futur Etat palestinien ne sera pas gouverné par une organisation classée terroriste, et offrir aux opinions arabes l’image d’un processus « pragmatique » qui place l’Autorité palestinienne au centre du jeu. Dans l’architecture du texte, le Hamas devient un problème à résoudre, un acteur à effacer. Le message est adressé aussi bien à Washington qu’à Bruxelles : la reconnaissance n’est pas un blanc-seing, elle passe par une condition sécuritaire. En ajoutant la perspective d’une mission internationale de stabilisation et de protection des civils à Gaza, les rédacteurs entendaient rassurer encore davantage. La rhétorique est léchée : on parle d’« étapes tangibles, datées et irréversibles » pour créer un climat de confiance. Mais la mécanique est fragile, car elle repose sur des hypothèses peu réalistes.
En effet, placer l’Autorité palestinienne au cœur de la solution revient à ignorer son discrédit massif auprès de la population. En Cisjordanie, l’Autorité palestinienne est accusée depuis des années d’apathie face aux violences des colons, qui se sont multipliées sans réponse notable. Les forces de sécurité palestiniennes coopèrent avec Israël dans le cadre d’accords sécuritaires, mais sans obtenir de concessions sur l’expansion des colonies. Résultat : aux yeux de nombreux Palestiniens, leur représentation politique n’est plus un instrument d’émancipation, mais un rouage d’un système qui les enferme. Faire reposer sur elle la transition à Gaza ressemble à une fuite en avant diplomatique : on recycle un acteur délégitimé au lieu de traiter la question de fond.
Ensuite, demander au Hamas de remettre ses armes suppose une rationalité stratégique que la réalité contredit. Pourquoi céder ses moyens de pression alors que la colonisation s’accélère, que Netanyahou réaffirme son refus d’un État palestinien et que les frappes israéliennes continuent ? Pire : le leadership politique du Hamas a été directement ciblé par un bombardement israélien illégal au Qatar, renforçant l’idée que toute concession équivaut à une reddition. Dans ce contexte, l’appel au désarmement ressemble moins à une étape de paix qu’à une injonction irréalisable, voire provocatrice. Le Hamas, affaibli militairement mais toujours enraciné dans une partie de la population, n’a aucune raison de se dépouiller au profit d’une Autorité palestinienne discréditée.
Puis, l’autre pilier de la feuille de route, la mission internationale, se heurte aux limites matérielles et politiques de l’ONU. Les opérations de maintien de la paix sont déjà menacées par les coupes budgétaires américaines, qui représentent la première contribution au budget onusien. Washington a annoncé en mai dernier qu’il envisageait de réduire drastiquement, voire de supprimer une partie de son financement des missions de paix, paralysant l’organisation avant même qu’un déploiement ne soit envisagé. À cela s’ajoutent les manœuvres administratives : les Etats-Unis ont restreint l’accès aux visas pour certaines délégations, y compris palestiniennes, compromettant la participation au débat onusien. Dans ces conditions, imaginer des Casques bleus ou une force internationale à Gaza relève plus du vœu pieux que du projet concret.
Enfin, un autre angle mort de cette feuille de route tient à l’absence des grandes puissances non occidentales. Ni la Chine, ni la Russie n’ont été associées à la rédaction du texte de juillet. Or, sans elles, il est illusoire d’espérer une mission internationale qui ait du poids. Les deux capitales sont pourtant prêtes à endosser un rôle si cela permet de fragiliser le tandem américano-israélien. Leur absence volontaire souligne la fragilité de l’initiative franco-saoudienne : conçue pour afficher un consensus, elle est privée de relais capables d’imposer le respect du terrain.
Reconnaissances en cascade ou diplomatie creuse ?
Le mot « reconnaissance » a toujours eu deux faces : la légitimité juridique qu’elle confère et l’usage politique qu’en font les chancelleries. Plus de 140 États reconnaissent déjà la Palestine depuis les années 1980, mais ce chiffre a longtemps été considéré comme marginal dans les rapports de force, faute d’inclusion des grandes puissances occidentales. C’est ce verrou que la vague récente prétend faire sauter. En 2024, Madrid, Dublin, Ljubljana et Oslo avaient ouvert le bal, élargissant la brèche au cœur de l’Europe. En juillet 2025, Paris a suivi, accompagnée d’une campagne de communication intense (il faut également rappeler que, dans les faits, la France reconnait déjà l’Etat palestinien et traite avec lui). Mais cette re-reconnaissance française, comme celles qui l’ont précédée, n’a pas encore produit l’effet cumulatif espéré : Israël conserve l’avantage militaire, les États-Unis restent fermement opposés, et aucune sanction économique ou diplomatique n’accompagne ces gestes symboliques.
Pourtant, la portée juridique n’est pas négligeable. En droit international, reconnaître un État, c’est admettre sa personnalité juridique pleine et entière : il peut signer des traités, établir des ambassades, bénéficier d’immunités diplomatiques. L’Autorité palestinienne peut ainsi se prévaloir d’un statut élargi dans ses démarches devant les juridictions internationales, notamment la Cour pénale internationale où sont instruites des plaintes pour crimes de guerre. C’est là que se joue un autre front : transformer les votes diplomatiques en leviers judiciaires pour contester la légalité des colonies, des expulsions, et des blocus.
La dynamique ne se limite pas à l’Europe. En Amérique latine, plusieurs pays — du Brésil au Chili — utilisent déjà la reconnaissance comme une arme politique pour s’affirmer face à Washington. En Afrique, le vote massif à l’ONU traduit la permanence d’un soutien populaire et gouvernemental, hérité des solidarités de la guerre froide et des luttes anticoloniales. Autrement dit, la reconnaissance n’est pas seulement un geste européen, c’est une réalité majoritaire dans le Sud global, qui considère la Palestine comme un miroir de ses propres combats.
Du côté palestinien, l’effet est ambivalent. Mahmoud Abbas et l’Autorité palestinienne saluent chaque nouvelle reconnaissance comme une victoire diplomatique, mais dans la rue, l’enthousiasme reste mesuré. Beaucoup rappellent que l’État palestinien est reconnu depuis 1988 par une large majorité de pays et que cela n’a pas empêché la colonisation de s’étendre, ni les offensives militaires de se répéter. Les ONG locales parlent d’« État de papier », célébré dans les communiqués mais absent sur le terrain.
L’Europe, enfin, affronte un dilemme stratégique. Elle peut transformer la reconnaissance en instrument de pression — suspension des accords commerciaux, gel de la coopération militaire avec Israël, conditionnement de l’accès au marché européen. Ou elle peut s’en tenir à des proclamations sans suite, confirmant que la diplomatie n’est qu’un théâtre où l’on applaudit à New York pendant que les bulldozers avancent en Cisjordanie et à Gaza, et que le génocide des Palestiniens se poursuit. C’est ce choix qui décidera si la séquence de reconnaissance marque une rupture, ou si elle restera une illusion supplémentaire dans la longue histoire des promesses non tenues faites aux Palestiniens.