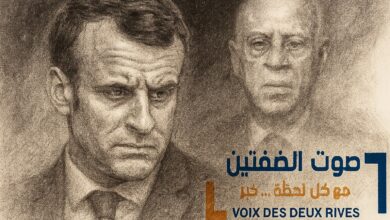Nizar jlidi écrit/ Snapback européen, rapprochement discret : Téhéran et Riyad déplacent le centre de gravité
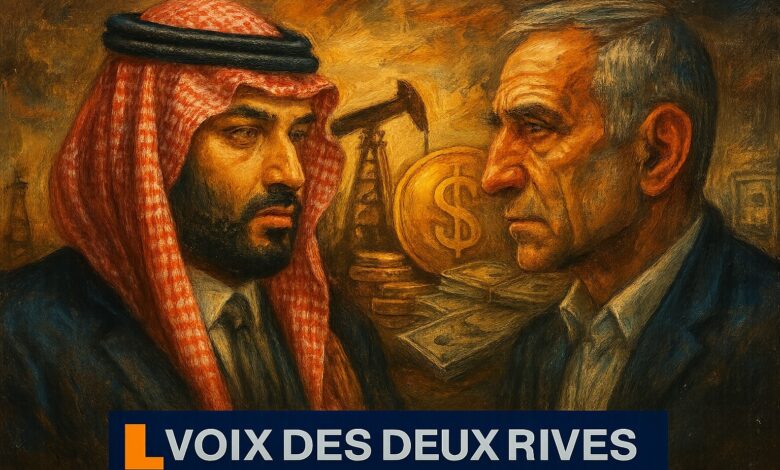

À New York, l’Europe a réactivé le mécanisme des sanctions onusiennes contre l’Iran, une première depuis une décennie. Mais derrière ce succès procédural, Téhéran montre une résilience calculée : il rappelle ses ambassadeurs, encaisse la chute du rial, mais conserve son levier nucléaire et militaire. Le tout, dans un contexte où les véritables gagnants semblent se trouver ailleurs — à Pékin et à Moscou.
La dernière semaine de l’Assemblée générale de l’ONU a illustré une ligne de fracture grandissante. L’E3 — France, Allemagne, Royaume-Uni — a déclenché le « snapback » des sanctions du Conseil de sécurité, accusant l’Iran de manquer de transparence. À Téhéran, la riposte n’a pas tardé : rappel des envoyés à Paris, Berlin et Londres, effondrement du rial sur le marché noir, mais aussi une rhétorique ferme. Le président MasoudPezeshkian a martelé : « Si le but avait été de résoudre les préoccupations sur le nucléaire, nous aurions pu le faire facilement. Mais tant qu’Israël et les États-Unis utiliseront la pression pour tenter de renverser le régime, aucun accord n’est possible ».
Les Européens présentent leur « victoire » comme un retour au droit. Dans une lettre officielle, Paris, Londres et Berlin ont justifié leur recours au mécanisme onusien par la « non-performance significative » de l’Iran à ses engagements nucléaires. Mais sur le terrain, l’effet n’est pas celui d’un Etat acculé.
Certes, la monnaie iranienne a atteint un record historique — plus d’1,1 million de rials pour un dollar — et les sanctions réimposées visent des secteurs stratégiques : nucléaire, bancaire, maritime, militaire. Mais l’Iran a réagi sans céder sur ses lignes rouges. Le président Pezeshkian a répété devant l’Assemblée générale : « L’Iran ne construira jamais d’arme nucléaire. » En parallèle, l’Agence internationale de l’énergie atomique a confirmé la reprise d’inspections partielles sur des sites sensibles, offrant à l’Iran un bouclier diplomatique minimal sans renoncer à son autonomie.
À l’ONU, la Russie et la Chine ont dénoncé la décision européenne comme « nulle et non avenue ». Le vice-ambassadeur russe DmitryPolyansky a insisté sur « l’illégitimité » d’un processus enclenché sans consensus, tandis que la Chine a promis de maintenir ses achats de pétrole iranien malgré les menaces de sanctions secondaires. En miroir, Trump a affiché une ambiguïté calculée : son envoyé Steve Witkoff a affirmé que le snapback était « le bon remède pour la situation », tout en ajoutant : « Nous sommes en contact, nous parlons à l’Iran ».
Face à cette mosaïque de positions, Téhéran se présente non pas en Etat isolé, mais en acteur qui absorbe le choc et garde l’initiative. En choisissant de rester dans le Traité de non-prolifération nucléaire, malgré les pressions, le pouvoir iranien affiche une stratégie de résilience : encaisser les coups, éviter de donner un casus belli, et maintenir ses leviers régionaux intacts.
Riyad et Téhéran : un rapprochement discret mais stratégique
Au-delà des sanctions, un autre mouvement plus discret se dessine : la main tendue du Hezbollah à l’Arabie saoudite, encouragée par Téhéran. Le secrétaire général adjoint du parti chiite, Naïm Kassem, a lancé un appel inhabituel : « Ouvrir une nouvelle page avec l’Arabie saoudite », afin de « mettre de côté les différends passés » pour faire face à Israël. Selon plusieurs sources, ce geste n’est pas spontané. C’est Ali Larijani, conseiller du guide suprême, qui aurait poussé en ce sens après une visite à Riyad.
Cette diplomatie parallèle illustre le pragmatisme iranien. Téhéran sait que son influence au Liban est fragilisée par les pertes du Hezbollah dans la guerre de l’été précédent. Le calcul est simple : au lieu de laisser son allié s’isoler, il encourage un geste d’ouverture vers son rival historique. L’Arabie saoudite, fidèle à sa ligne de principe — l’Etat seul détient le monopole des armes — n’a pas répondu favorablement. Mais le simple fait que cette tentative existe indique une évolution : l’Iran cherche à désamorcer certains fronts pour consolider d’autres.
En arrière-plan, Moscou et Pékin trouvent leur intérêt. La Russie, engluée dans son isolement occidental, cherche à élargir son camp des « sanctionnés résilients ». La Chine, de son côté, voit dans un axe saoudo-iranien un verrou énergétique majeur : deux des premiers exportateurs mondiaux de pétrole parlant désormais un langage au moins coordonné. Xi Jinping, qui a été le médiateur du rapprochement irano-saoudien de 2023, peut se prévaloir d’un succès diplomatique qui grignote encore l’influence américaine.
Quant aux Européens, ils apparaissent de plus en plus comme les perdants de cette recomposition – de toutes les recompositions, réellement. L’E3 a certes remporté une bataille procédurale à l’ONU, mais il s’isole davantage dans un camp occidental où les Etats-Unis eux-mêmes hésitent. Washington a beau sanctionner des entreprises chinoises liées au pétrole iranien, il sait que la dépendance énergétique mondiale limite la portée réelle de ces mesures.
Le jeu américain, les risques iraniens et la recomposition du monde sunnite
Le paradoxe américain est au cœur de la séquence actuelle. Officiellement, Washington assume une position ferme : « Cette résolution établit une fausse équivalence dangereuse entre Israël et le Hamas. Il ne peut y avoir d’équivalence entre les deux, un point c’est tout », déclarait honteusement la représentante américaine à l’ONU en justifiant le veto contre un cessez-le-feu à Gaza. Dans le même souffle, elle rappelait que « le président Trump a clairement indiqué que les 48 otages devaient être libérés maintenant ». Ce ton s’accorde avec la logique américaine de soutien absolu à l’entité sioniste, mais il complique la tâche de Riyad. Car chaque geste saoudien vers Téhéran est scruté à Washington, et rien n’indique que la Maison-Blanche souhaite torpiller un rapprochement qu’elle pourrait utiliser comme levier contre la Chine.
L’Iran, lui, joue serré. Il accepte le retour des sanctions, qu’il qualifie de « prétexte superficiel pour embraser la région », selon le président MasoudPezeshkian, tout en refusant la fuite en avant nucléaire : « L’Iran ne cherchera jamais à obtenir l’arme atomique », a-t-il répété. Mais cette posture défensive n’empêche pas Téhéran d’afficher sa capacité de nuisance. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a profité des commémorations à Beyrouth pour réaffirmer que « la résistance active et intelligente reste la seule voie face à l’expansionnisme israélien ». Autrement dit : les sanctions économiques ne feront pas plier un régime qui a survécu à quarante ans de blocus et d’isolement.
Dans ce contexte, la recomposition du monde sunnite pèse lourd. L’Arabie saoudite et la Turquie cherchent depuis plusieurs années à bâtir un « croissant sunnite » informel, capable de contrebalancer l’Iran chiite. Mais l’évolution régionale fragilise cette logique. Ankara, obsédée par ses ambitions en Méditerranée et dans le Caucase, voit dans Téhéran un partenaire tactique plutôt qu’un ennemi structurel. Quant à Riyad, il doit jongler entre son rôle de pilier sunnite et la nécessité d’un dialogue avec l’Iran pour stabiliser ses frontières et sécuriser ses projets économiques, notamment ceux de « Vision 2030 ».
En réalité, l’Iran réussit un pari risqué : s’immiscer dans ce croissant sunnite sans chercher à le briser, mais en se présentant comme une force incontournable dans toute architecture régionale. Ce qui paraissait impossible il y a encore cinq ans — voir Riyad, Ankara et Téhéran discuter du même ordre régional — est désormais une donnée de travail. Pour Pékin et Moscou, c’est une aubaine. La Chine sécurise son corridor énergétique, la Russie consolide ses relais politiques dans le Golfe et en Méditerranée. Les grands perdants, encore une fois, semblent être les Européens, qui assistent en spectateurs à la naissance d’un axe où leur voix pèse de moins en moins.
Les intérêts américains derrière le « snapback »
Si Washington a toléré un rapprochement prudent entre Riyad et Téhéran, c’est en partie parce qu’il conserve d’autres leviers pour garder la main dans le jeu régional. Le recours au mécanisme de « snapback », qui réactive les sanctions onusiennes contre l’Iran, illustre cette logique. Comme l’explique un rapport du Washington Institute, ce dispositif « a peut-être beaucoup plus d’impact politique qu’économique — les intérêts américains sont mieux servis en alimentant la paranoïa iranienne qu’en cherchant une application stricte », dit le rapport.
Derrière cette stratégie se dessine une double préoccupation. D’abord, il s’agit, pour les Américains, de rassurer Israël et les monarchies du Golfe sur la solidité du parapluie sécuritaire. Benjamin Netanyahu l’a rappelé récemment en exhortant la communauté internationale à « ne pas retarder le snapback » et en laissant entendre que son pays pourrait frapper à nouveau les installations nucléaires iraniennes. De l’autre, Washington veut éviter que l’apaisement irano-saoudien ne soit interprété comme un recul de son influence au profit des Russes et des Chinois. Dans un rapport du Middle East Institute, les Etats-Unis soulignent la nécessité de « défendre leurs alliés régionaux face aux menaces iraniennes » tout en contrant la montée en puissance des puissances rivales.
L’intérêt américain est aussi économique. En frappant les réseaux iraniens de transport maritime et de contournement des sanctions, Washington cherche à limiter les revenus pétroliers de Téhéran et à affaiblir sa capacité à financer ses alliés régionaux. Comme l’a résumé Steve Witkoff, envoyé américain pour le Moyen-Orient, « le snapback est le bon remède pour la situation ». Le terme de « remède » est révélateur : il s’agit moins de guérir le mal que de maintenir l’Iran dans un état de dépendance et de vulnérabilité, quitte à assumer les contradictions d’une politique qui prétend rester ouverte au dialogue.
Mais ce calcul comporte des risques. Trop de pression pourrait pousser l’Iran à rehausser son niveau d’enrichissement ou à menacer de quitter certaines clauses du Traité de non-prolifération. Un autre effet pervers serait de pousser Riyad, soucieux de ne pas apparaître prisonnier d’un agenda américain, à accélérer sa diversification diplomatique en direction de la Chine ou de la Russie. Ainsi, ce que Washington présente comme une arme de stabilisation pourrait paradoxalement accentuer les lignes de fracture, dans une région où les équilibres sont déjà fragiles.
L’Iran et la stratégie du risque calculé
Face au retour des sanctions onusiennes et à la pression israélo-américaine, Téhéran mise sur une stratégie à double tranchant : afficher sa résilience tout en multipliant les ouvertures tactiques. Le président MasoudPezeshkian a ainsi martelé qu’« aucun accord n’est possible tant qu’Israël et les Etats-Unis utilisent la pression pour tenter de renverser le régime ». Ce discours, loin d’être purement défensif, vise à convaincre ses partenaires potentiels que la République islamique est un acteur rationnel, déterminé à protéger sa souveraineté sans provoquer une rupture irréversible.
Dans les faits, la République islamique joue un jeu subtil. Elle accepte le retour partiel des inspections de l’AIEA, mais refuse toute concession supplémentaire, préférant transférer la pression sur ses adversaires. L’idée est de maintenir une « zone grise » : assez de coopération pour éviter une condamnation unanime, mais suffisamment de fermeté pour afficher son indépendance.
Ce calcul se déploie aussi sur le plan régional. En encourageant le Hezbollah à tendre la main à l’Arabie saoudite, l’Iran teste la solidité des lignes rouges américaines, tout en forçant Riyad à choisir entre son agenda de désescalade et ses engagements sécuritaires aux côtés de Washington. Comme l’a confié une source proche du Hezbollah, « Naïm Kassem n’aurait jamais lancé son appel sans un signal de Téhéran » (source libanaise citée par Al-Akhbar).
À court terme, Téhéran sait qu’il ne pourra empêcher la réimposition des sanctions. Mais il espère retourner cette contrainte à son avantage en apparaissant comme la victime d’un ordre international biaisé, et en renforçant ses liens avec Moscou et Pékin, qui dénoncent ouvertement le snapback. À moyen terme, l’Iran joue une carte plus ambitieuse : se poser en alternative crédible à un système dominé par l’Occident, quitte à alimenter la méfiance européenne.
Cette stratégie du risque calculé n’est pas sans périls. Elle pourrait pousser Israël à multiplier les frappes ciblées, ou offrir à Washington un prétexte pour durcir encore son dispositif de sanctions. Mais aux yeux de Téhéran, c’est le prix à payer pour ne pas apparaître comme un Etat faible — et pour continuer à tisser, discrètement mais fermement, les fils d’un nouvel équilibre régional.
Énergie et routes commerciales : le véritable basculement
Au-delà du nucléaire et des rivalités militaires, le rapprochement discret entre Riyad et Téhéran redessine surtout la carte énergétique mondiale. Ensemble, les deux pays contrôlent près de 30 % des réserves prouvées de pétrole et des capacités d’exportation qui restent vitales pour l’Asie, l’Europe et, dans une moindre mesure, les Etats-Unis. Si la coordination entre l’Arabie saoudite, chef de file de l’OPEP+, et l’Iran, longtemps marginalisé par les sanctions, devenait plus étroite, c’est tout l’équilibre des marchés pétroliers qui basculerait.
Les Européens, déjà affaiblis par la perte du gaz russe, verraient leur dépendance accrue vis-à-vis d’un Golfe désormais plus aligné sur Moscou et Pékin que sur Washington ou Bruxelles. Le « snapback » européen, censé isoler l’Iran, risque paradoxalement d’accélérer cette bascule en poussant Riyad à explorer davantage les marges de manœuvre offertes par la Chine et la Russie. Pékin, premier importateur mondial de brut, verrait consolidée sa stratégie de sécurisation énergétique à long terme, tandis que Moscou bénéficierait d’une coordination renforcée au sein d’un cartel pétrolier de fait.
La dimension commerciale est tout aussi stratégique. Le détroit d’Hormuz, par où transite un cinquième du pétrole mondial, reste sous l’influence directe de l’Iran, tandis que Riyad accroît son emprise sur la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb, point de passage vital entre l’océan Indien et la Méditerranée. Si ces deux États venaient à coordonner leurs politiques maritimes, ils détiendraient ensemble la clé des routes énergétiques – et commerciales en général – entre Asie, Afrique et Europe. Dans un contexte où la sécurité des couloirs maritimes est déjà fragilisée par le génocide israélien à Gaza et les tensions en mer Rouge qui en résultent. Le message est clair : l’axe Riyad-Téhéran peut peser bien au-delà de la seule rivalité religieuse et idéologique.
Ce déplacement du centre de gravité vers l’Eurasie et l’océan Indien n’est pas qu’un scénario théorique. Il reflète l’émergence d’un monde où les décisions énergétiques et commerciales ne passent plus exclusivement par Washington, Londres ou Bruxelles, mais par un triangle de coopération entre Riyad, Téhéran et Pékin, avec Moscou en arrière-plan.