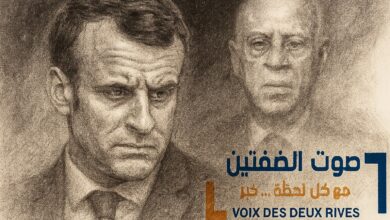Nizar Jlidi écrit: Prix Nobel de la paix oudu sionisme ?
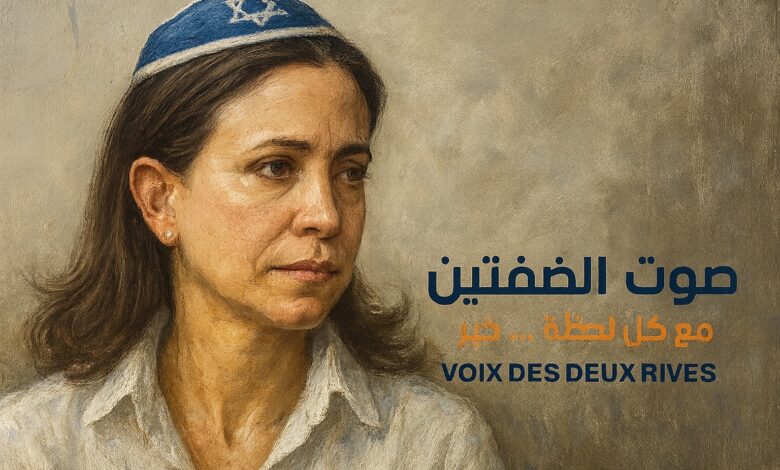

En sacrant la « Thatcher vénézuélienne » Maria Corina Machado, le comité d’Oslo n’a pas seulement couronné une opposante d’un pouvoir dictatorial : il a envoyé un signal. Ce n’est pas tant une ode à la démocratie qu’une confirmation — brutale et publique — d’un Nobel devenu instrument de politique étrangère libérale et occidentale. Entre accolades de Bruxelles, félicitations de Tel-Aviv et la rage d’une Maison-Blanche privée de trophée, le prix 2025 dit une chose simple : il faut être, notamment, organiquement sioniste pour être primé.
Le geste est classique et terriblement efficace : choisir une figure qui concentre à la fois l’apitoiement moral et l’appui stratégique. Maria Corina Machado, élue par Oslo lauréate Nobel 2025, coche ces cases. Elle a vécu l’exil intérieur — la clandestinité, la privation du droit de se présenter — et elle incarne la ligne dure contre Maduro. Mais elle présente aussi l’autre face du décor : des alliances affichées avec le Likud, des déclarations de solidarité (trop répétées) avec Israël depuis le 7 octobre 2023, et un programme qui promet de rapprocher Caracas de Washington (et, par ricochet, de Tel-Aviv).
Le comité ne s’en cache pas : il honore « la lutte pour une transition juste et pacifique vers la démocratie ». Les institutions occidentales applaudissent, l’ONU parle d’un « hommage à l’aspiration populaire », l’institut de recherche sur la paix d’Oslo (PRIO) évoque un « prix pour la démocratie ». Mais dans le bruissement des réactions, une autre musique s’impose — celle d’une pseudo-diplomatie qui sait reconnaître ses alliés et récompenser leurs signes d’allégeance. D’où la question : Oslo célèbre-t-elle la résistance civique… ou valide-t-elle une trajectoire géopolitique ?
Machado, le profil idéal : courage civique ou marqueur géopolitique ?
Le récit qu’Oslo a choisi est simple et puissant. Maria Corina Machado, 58 ans, ingénieure de formation, a émergé comme la tête d’un mouvement d’opposition fragmenté — elle a unifié les rivalités, mobilisé dans la rue et, dit le comité, incarné la « résistance pacifique » dans un pays où la répression a muselé nombre de dirigeants. Sa vie en clandestinité offre la scène parfaite : la lauréate n’est pas une expatriée médiatique, elle est restée sur place, « forcée de vivre dans l’ombre », selon la formulation officielle. C’est l’archétype du « héros Nobel ».
Mais ce profil contient des aménagements politiques qui comptent. Machado n’a pas uniquement porté un discours sur les urnes : elle a pris des positions nettes qui la positionnent dans la géopolitique de notre temps. Elle a publiquement salué Israël après le 7 octobre 2023 ; elle a contracté des accords de coopération avec le Likud, et a promis — si elle venait au pouvoir — de « déplacer l’ambassade vénézuélienne à Jérusalem ». Ces éléments ne sont pas anecdotiques : ils font d’elle une interlocutrice confortable pour Washington et Tel-Aviv. Quand Oslo la couronne, ce n’est pas seulement la démocratie vénézuélienne qu’on loue ; c’est aussi une allégeance stratégique à l’Occident « libéral ».
Les réactions officielles le montrent sans détour. Ursula von der Leyen salue un « puissant message pour la démocratie » ; PRIO parle d’un « prix pour les élections crédibles ». De l’autre côté, l’appareil diplomatique israélien et les milieux atlantistes trouvent dans l’affaire la confirmation que le prix sert à consolider des alliances : Machado cristallise, consciemment ou non, l’un des récits favoris des capitales occidentales — celui d’une opposition « modérée », pro-marché et pro-occidentale, susceptible d’être présentée comme alternative « légitime » face à un pouvoir qualifié sans nuance de « mafia ».
Ce choix — loin d’être neutre — répond à une logique politique pratique. Pour les gouvernements qui veulent fragiliser Maduro tout en garantissant un interlocuteur amical, Machado est le lauréat rêvé : courageuse sur le terrain, mais politiquement alignable en coulisses. Et pour Oslo, le bénéfice est immédiat : reconnaissance, retombées médiatiques, et une image de comité engagé sur la « défense des valeurs libérales » — même si ces valeurs se traduisent par des alliances géopolitiques explicites.
Le Nobel comme caisse de résonance occidentale
À peine l’annonce faite, les capitales occidentales se sont empressées d’applaudir. Ursula von der Leyen s’est posée en marraine officielle de l’événement : « la soif de liberté ne se muselle jamais ». Berlin a loué « l’engagement de longue date » de Machado, et Oslo, par la voix de Frydnes, a parlé d’une « inspiration pour des millions ». Ce concert n’est pas anodin : il traduit une logique de bloc.
Depuis deux décennies, le Nobel de la paix tend à fonctionner comme un instrument d’alignement : on consacre des figures qui renforcent le récit occidental, même si leur parcours réel est plus ambigu. Après Narges Mohammadi (Iran) en 2023, c’est donc au tour du Venezuela, présenté comme théâtre d’une lutte binaire entre dictature et démocratie. Le choix a une portée symbolique immédiate : il donne une caisse de résonance internationale à l’opposition vénézuélienne et, indirectement, aux alliés de Caracas en exil.
Mais cette consécration est à sens unique : l’ONU félicite Machado, mais reste muette sur sa position quantaux dizaines de milliers de morts à Gaza. Les mêmes institutions qui encensent le « courage » au Venezuela peinent à qualifier de crime de guerre le génocide du peuple de la bande côtière palestinienne. C’est là que la critique enfle : le Nobel devient une scène où l’Occident s’offre une image morale à bon compte, tout en escamotant d’autres drames.
Trump, l’obsession frustrée
Le contraste avec Donald Trump est saisissant. Depuis des mois, l’ancien promoteur immobilier reconverti en chef de guerre diplomatique répétait qu’il « méritait » le Nobel. Il a listé huit conflits prétendument réglés — de Gaza à l’Éthiopie, en passant par le Caucase — et s’est autoproclamé « pacificateur de l’Histoire ». L’ombre d’un prix refusé plane sur chacune de ses déclarations.
La Maison-Blanche a réagi avec amertume : « Le comité a choisi la politique contre la paix », a accusé Steven Cheung. Pour Trump, c’est une humiliation symbolique : il a soutenu Israël sans condition, il a piloté une trêve temporaire à Gaza, il a mené une diplomatie transactionnelle qui lui semblait assez spectaculaire pour valoir un trophée. Mais Oslo a tranché : ses guerres arrêtées ne sont pas jugées « crédibles » ou « durables », ses méthodes trop brutales pour la légende du Nobel.
L’ironie est double : d’un côté, on glorifie une opposante qui n’a jamais gouverné et dont le programme est aligné sur l’agenda occidental ; de l’autre, on dédaigne un président qui, quoi qu’on pense de lui, a mis les mains dans le cambouis de la guerre au Proche-Orient. Pour ses partisans, l’injustice est flagrante. Pour ses adversaires, la sélection du comité confirme que le Nobel n’est pas un prix « neutre », mais une récompense distribuée selon des codes idéologiques.
Un prix devenu instrument politique
Le cas Machado illustre une tendance ancienne : le Nobel de la paix récompense moins des artisans de réconciliation que des figures symboliques, utiles à un récit. Gandhi n’a jamais eu le prix. Kissinger, acteur du carnage au Vietnam et au Cambodge, l’a décroché en 1973. Barack Obama l’a reçu en 2009, avant d’intensifier la guerre des drones. Aujourd’hui, Machado, qui soutient ouvertement Israël, Netanyahu et le transfert de l’ambassade à Jérusalem, est propulsée au rang d’icône mondiale.
Cette politisation est flagrante : ses écrits en faveur d’une intervention étrangère au Venezuela, ses accords signés avec le Likud, son appui au génocideà Gaza — tout cela aurait dû disqualifier une candidature au nom même des principes d’Alfred Nobel. Mais c’est précisément cette proximité idéologique qui a pesé dans la balance. On ne couronne pas une militante vénézuélienne isolée : on adoube une alliée de Washington et de Tel-Aviv.
Pour les critiques, ce choix sape la crédibilité de l’institution. Quand le Conseil pour les relations américano-islamiques dénonce une « décision inconcevable », il exprime une colère plus large : le Nobel est perçu comme complice du récit occidental, validant certains crimes tout en invisibilisant d’autres résistances.
La désignation de Machado, au-delà de la polémique, acte une mutation : le Nobel n’est plus un espace de reconnaissance universelle, mais un champ de bataille symbolique. Il distribue des médailles qui rassurent les chancelleries occidentales, galvanisent leurs protégés et marginalisent les voix dissidentes.
Trump peut bien s’estimer floué, il n’est qu’une victime collatérale d’un système qui ne récompense plus la paix, mais la conformité idéologique. Les guerres se poursuivent, Gaza brûle, l’Ukraine s’enlise, Taïwan est menacé. Mais Oslo, fidèle à ses routines, préfère sanctifier une militante pro-israélienne présentée comme « l’avenir de la démocratie ».
Derrière les discours lyriques sur « le courage et l’espérance », une évidence s’impose : les Nobel de la paix consacrent désormais moins la paix que le pouvoir.