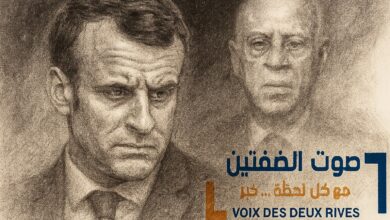NIZAR JLIDI écrit : Erdogan, l’ami de tous et l’ennemi de chacun : l’Europe dans le viseur
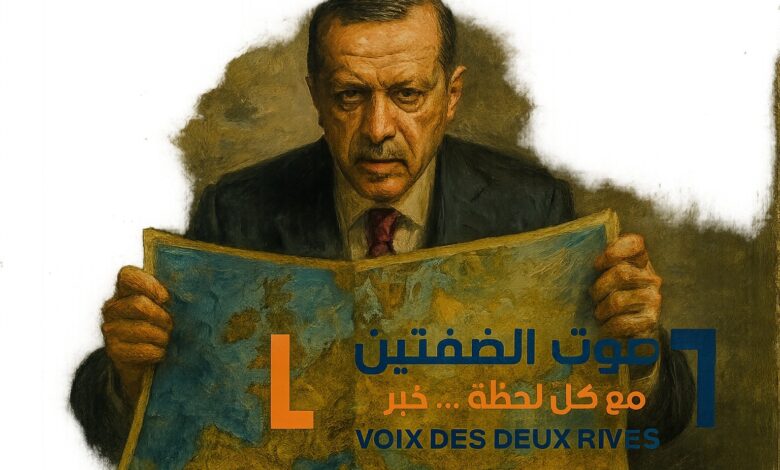

La Turquie se présente comme l’héritière d’un empire disparu, prétend défendre les peuples musulmans et multiplier les alliances tous azimuts. Mais derrière la rhétorique néo-ottomane d’Erdogan, un constat s’impose : c’est bien l’Europe, affaiblie et divisée, qui constitue l’horizon stratégique de ses ambitions.
Recep Tayyip Erdogan aime manier les symboles. Dans son palais d’Ankara, chaque détail évoque une Turquie impériale, fière de son passé et tournée vers un avenir qu’il prétend conquérir. À l’extérieur, le discours s’habille de références aux sultans et à la « Mavi Vatan », la « patrie bleue » censée étendre l’influence turque sur la Méditerranée. Mais ces images séduisent surtout l’opinion intérieure.
Sur la scène internationale, le président turc pratique une stratégie plus pragmatique : acheter des avions européens tout en vantant la construction d’un chasseur national, dénoncer Israël tout en maintenant avec lui un commerce florissant, s’afficher aux côtés de Poutine et Xi Jinping sans jamais rompre avec l’OTAN. Ami de Moscou, de Washington, des monarchies arabes ou de la Chine, Erdogan cultive l’art du grand écart diplomatique.
Cet équilibre instable n’a rien d’improvisé. Il reflète une ambition précise : faire de la Turquie un acteur incontournable sur le continent européen. Car si Ankara se projette au Maghreb, au Moyen-Orient ou en Asie, c’est en Europe que se trouvent ses leviers les plus puissants : union douanière, dépendances énergétiques, migrations, et un voisinage balkanique où l’influence turque ne cesse de croître.
Un double jeu assumé : acheter à l’Ouest, promettre l’indépendance
Ankara met en scène son autonomie militaire, mais ses choix révèlent surtout une dépendance calculée. L’achat récent de 20 jets EurofighterTyphoon auprès du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie — un contrat de près de huit milliards de livres sterling conclu le weekend dernier — illustre ce paradoxe. Officiellement, ces avions doivent combler un vide capacitaire en attendant l’entrée en service du KAAN, chasseur de cinquième génération conçu par l’industrie militaire turque. Dans les faits, ils maintiennent la Turquie dans le giron technologique de l’OTAN et assurent une interopérabilité totale avec les forces européennes.
Le discours officiel vante pourtant l’« indépendance nationale » et l’« ère KAAN » censée libérer Ankara des contraintes occidentales. Erdogan multiplie les annonces spectaculaires autour de ce programme, présenté comme la vitrine de la puissance industrielle turque. Mais derrière les slogans, la réalité est moins flatteuse : la motorisation du KAAN reste importée, sa chaîne logistique dépend encore largement de sous-traitants occidentaux, et les délais accumulés montrent la fragilité du projet.
Ce grand écart entre rhétorique et pratique n’est pas accidentel. Erdogan soigne son électorat nationaliste en brandissant le mythe d’une Turquie autosuffisante, tout en négociant discrètement avec Londres et Berlin pour rester arrimé au système de défense européen. En matière aérienne, Ankara joue ainsi une partition ambiguë : parler de souveraineté à Ankara, mais assurer sa place à Bruxelles.
Mavi Vatan : la mer comme champ d’expansion
Si Ankara compense son retard aérien par des achats extérieurs, c’est sur la mer qu’elle met en avant son originalité. La doctrine dite Mavi Vatan (« patrie bleue ») consacre la Méditerranée orientale comme zone d’expansion vitale. Sous ce concept, la Turquie déploie drones navals, frégates modernisées et une flotte sous-marine en pleine extension. L’objectif est clair : verrouiller ses eaux, contester les zones économiques exclusives grecques et chypriotes, et apparaître comme incontournable dans la répartition des ressources gazières.
Ce militarisme maritime est soutenu par un effort industriel soutenu. Les drones Bayraktar, qui ont acquis une réputation internationale en Libye et en Ukraine, sont désormais adaptés au domaine naval. Ils patrouillent la mer Égée et projettent l’image d’une puissance technologique turque. Mais là encore, l’indépendance est relative : nombre de composants essentiels viennent d’Europe ou du Canada, et Ankara contourne les embargos par des accords parallèles avec le Qatar ou l’Azerbaïdjan.
La stratégie maritime d’Erdogan dépasse la seule Méditerranée. En Libye, la présence militaire turque s’est consolidée autour de Misrata, point d’ancrage logistique vers l’Afrique du Nord. En mer Rouge, Ankara cultive son partenariat avec le Soudan, qui avait un temps accepté un bail turc sur l’île de Suakin, avant de revenir partiellement sur l’accord. Ces relais maritimes ne forment pas encore un réseau comparable à ceux de la Chine, mais ils dessinent une volonté : afficher un rôle de puissance navale capable de concurrencer la France et l’Italie dans leurs anciens bastions coloniaux.
L’Afrique et le Golfe, vitrines de puissance et contradictions
En Afrique, Erdogan s’est imposé comme un visiteur assidu. Ambassades ouvertes en série, forums d’affaires, desserte aérienne élargie : la Turquie a tissé en une décennie un réseau diplomatique dense. Mais la façade économique masque un agenda plus dur. À Mogadiscio, sa base militaire forme des bataillons entiers et assure un accès sur l’océan Indien. Dans le Sahel, ses drones trouvent preneurs auprès de régimes en rupture avec l’Europe, notamment les pays d’Afrique de l’Ouest aujourd’hui dirigés par les juntes militaires. En Libye, ses conseillers militaires et ses sociétés de sécurité défendent Tripoli, transformant le pays en banc d’essai pour l’industrie de défense turque.
Le Moyen-Orient offre un autre théâtre de contradictions. Erdogan s’affiche en champion de la cause palestinienne, dénonce Tel-Aviv dans ses discours, mais le commerce bilatéral avec Israël atteint des sommets. Avec le Qatar, l’alliance idéologique autour des Frères musulmans reste vive ; avec Riyad et Abou Dhabi, il a su solder les querelles pour retrouver des contrats, surtout dans les finances et l’infrastructure. La diplomatie turque se nourrit de ces retournements rapides : l’ennemi d’hier devient l’allié du lendemain si les intérêts financiers ou militaires l’exigent.
Cette souplesse sert Ankara à occuper les vides laissés par les Européens. Elle montre aussi les limites d’une stratégie qui se construit par opportunités, plus que par cohérence. Derrière le discours fraternel, c’est une politique d’implantation calculée, pensée pour élargir l’espace d’influence turc dans des zones où l’Occident recule.
L’Europe, terrain ultime d’ambition et de vulnérabilité
Au-delà de la Méditerranée ou du Maghreb, c’est vers l’Europe que convergent les ambitions d’Erdogan. C’est là qu’il dispose de leviers puissants : les flux migratoires, le commerce, l’énergie et une diaspora active. L’accord de 2016 avec Bruxelles a officialisé ce rapport de force : chaque menace d’« ouvrir les portes » et de laisser passer des réfugiés vers la Grèce ou les Balkans se traduit par concessions financières ou diplomatiques. En Allemagne, en France ou aux Pays-Bas, les communautés turques deviennent des relais politiques que le pouvoir d’Ankara sait mobiliser.
Le volet économique renforce cette dépendance mutuelle. Près de la moitié des exportations turques vont vers l’Union européenne. Dans le même temps, Ankara se positionne comme couloir énergétique incontournable grâce aux gazoducs qui relient la Caspienne et la Russie au cœur du continent. Erdogan joue ainsi sur deux tableaux : se présenter en garant de la sécurité énergétique tout en accentuant les tensions en Méditerranée orientale, forçant la Grèce et Chypre à réagir militairement.
Son influence s’exerce aussi sur le plan culturel et religieux. Par le biais du Diyanet, la Turquie finance et encadre des centaines de mosquées en Europe occidentale. Chaque polémique autour de la laïcité ou de l’islamophobie devient un terrain de confrontation où Erdogan cherche à apparaître comme le protecteur des musulmans d’Europe. Cette stratégie fragilise les sociétés européennes en exportant les divisions politiques turques sur leur sol.
Erdogan ne rêve pas d’une conquête militaire, mais d’un rôle d’intrus permanent dans les mécanismes européens. Membre de l’OTAN, partenaire commercial majeur et acteur démographique par sa diaspora, la Turquie est déjà installée dans la maison. Le discours néo-ottoman flatte l’opinion intérieure ; la véritable bataille se joue à Bruxelles, à Berlin et à Paris, où Ankara cherche à transformer chaque faiblesse en levier politique.
Vers une Europe sous pression turque
Dans les cinq à dix prochaines années, le rapport de force entre Ankara et Bruxelles devrait se tendre davantage. La Turquie n’a pas besoin d’une confrontation ouverte – même diplomatique – pour s’imposer ; elle a choisi l’érosion progressive des défenses politiques européennes. Chaque crise devient pour Erdogan une opportunité : crise migratoire, flambée énergétique, tensions en Méditerranée orientale, divisions au sein de l’OTAN. À chaque fois, Ankara se positionne comme arbitre obligé, tout en entretenant les foyers de tension qui lui donnent ce rôle.
La perspective d’un affaiblissement continu de l’Union européenne nourrit cette stratégie. L’élargissement à l’Est divise les capitales, la dépendance énergétique reste forte, et les opinions publiques doutent de l’efficacité de l’Union européenne sous son leadership actuel. Erdogan joue sur ces vulnérabilités : il soutient les courants politiques eurosceptiques, encourage les clivages internes et cherche à transformer la Turquie en partenaire incontournable. L’arme migratoire reste son outil de prédilection, mais l’énergie et le commerce offrent d’autres atouts pour maintenir l’Europe dans un état de dépendance relative.
Cette manipulation ne vise pas la conquête militaire, mais un contrôle politique diffus. La Turquie ne rêve pas de planter son drapeau sur Athènes ou Paris ; elle ambitionne d’imposer ses priorités stratégiques à l’intérieur même du système européen. Influencer la politique migratoire, imposer sa vision en Méditerranée, obtenir des concessions industrielles et sécuritaires : autant d’objectifs réalistes pour un pouvoir turc qui connaît parfaitement les fissures de son voisin occidental.
En somme, les discours néo-ottomans mobilisent l’opinion intérieure, mais l’arène décisive se trouve bien en Europe. Erdogan n’aspire pas à reconstituer un empire disparu, il cherche à transformer l’Union européenne en un espace sous pression constante, contraint de composer avec Ankara dans tous les grands dossiers. C’est là que se joue, à long terme, sa véritable ambition : non pas régner sur les ruines de Byzance, mais s’asseoir, à sa manière, à la table des puissances qui décident pour le continent.
Erdogan ne bâtit pas un empire à coups de frontières tracées sur les cartes. Il construit une influence par infiltration, profitant des failles de ses voisins et de l’inertie des institutions européennes. Ses gestes spectaculaires en Méditerranée ou en Afrique séduisent son électorat, mais l’essentiel se joue ailleurs : dans les capitales européennes où se décident migrations, énergie, sécurité et équilibre interne de l’Union.
Là réside son pari : non pas reconquérir le passé, mais peser sur l’avenir du continent le plus fragile politiquement. L’Europe ne fait pas face à une menace venue de ses marges orientales ou de l’autre rive de l’Atlantique ; elle affronte déjà un partenaire encombrant qui se dit allié tout en sapant ses certitudes. Erdogan n’est pas seulement l’ami de tous et l’ennemi de chacun : il est l’invité permanent d’une Europe qui, faute de stratégie claire, de puissance militaire véritable ou de réelle économie, le laisse choisir la place qu’il occupe à sa table.