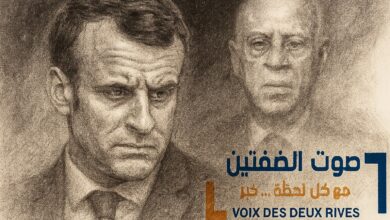Nizar jlidi écrit..La France va mal, mais qui paie vraiment l’addition ?


Il y a un malaise français que plus personne ne nie. Et il ne s’exprime plus seulement dans les urnes. Il se lit dans les visages fatigués des soignants, dans les silences lourds des enseignants, dans les soupirs des élus locaux, dans les regards perdus des jeunes sans emploi fixe ni repères. La France est devenue ce pays où chacun croit porter seul le poids d’un système à bout de souffle, pendant que d’autres tricheraient ou profiteraient. Le mot de trop, pour les uns, c’est « assistanat ». Pour les autres, c’est « réformes ». Mais ce qui se joue est plus profond : c’est une crise de cohésion, de confiance et d’horizon.
On cherche des coupables. Les politiques, bien sûr, reviennent en boucle dans le procès-verbal de cette déchéance collective. Mais il faut bien admettre que la machine s’est grippée ailleurs aussi. Depuis 40 ans, les grandes réformes économiques n’ont pas été menées par les majorités parlementaires, mais par une technocratie issue pour l’essentiel de l’Inspection des finances. Ce sont ces hauts fonctionnaires, passés maîtres dans l’art du compromis budgétaire, qui ont impulsé la dérégulation sans jamais refonder l’ossature de l’État. Ils ont promis l’efficience, ils ont livré la fragilité.
Et les chiffres sont là, implacables. Le déficit public, après une décennie de promesses de redressement, atteint 5,8 % du PIB en 2024. La dépense publique dépasse les 57 % du PIB — un record européen ou presque. La dette a franchi le seuil symbolique des 3 300 milliards d’euros, soit 113 % du PIB. Loin des critères de Maastricht, plus proche d’un modèle de gestion à la dérive. Le taux de prélèvements obligatoires, en légère baisse à 42,8 %, n’indique aucun répit pour les contribuables, seulement une perte de recettes. Et face à cela, aucune réforme d’ampleur, aucun réarmement de l’État social.
L’idée que la France souffre d’un « double déficit » revient dans tous les débats. Et pourtant, il faut nuancer : le solde du commerce extérieur s’est amélioré (–81 milliards, contre –162 milliards deux ans plus tôt), et la balance des paiements courants est même légèrement excédentaire. Mais ce répit conjoncturel ne dit rien de la vulnérabilité structurelle. La position extérieure nette reste négative (–22,9 % du PIB) : autrement dit, la France dépend toujours du financement extérieur. Et elle exporte toujours trop peu. Elle produit moins qu’elle ne consomme. Elle emprunte pour maintenir l’illusion d’un rang qu’elle n’assume plus.
Ce qu’elle continue de produire, en revanche, c’est de la dépense sociale. En 2023, la France a consacré 31,5 % de son PIB à la protection sociale — un chiffre qui la place largement en tête de l’Union européenne, près de 5 points au-dessus de la moyenne. Il serait absurde de dénoncer ces dépenses en bloc : elles protègent, soignent, indemnisent, soutiennent. Mais leur empilement, mal coordonné, mal piloté, pèse sur la soutenabilité du modèle. Et surtout, elles ne parviennent plus à réduire les inégalités, ni à enrayer le sentiment de déclassement. Le cœur du contrat social est percé. On paie beaucoup. On reçoit peu. On ne comprend plus qui bénéficie, ni pourquoi.
Ce sentiment se répercute dans les services publics. L’école, autrefois outil de promotion sociale, n’y parvient plus. Les derniers résultats PISA de 2022 sont cruels : les élèves français sont en recul marqué en mathématiques et en lecture, avec un taux de faibles performances parmi les plus élevés d’Europe occidentale. L’origine sociale pèse plus que jamais sur les résultats scolaires. Le destin est assigné tôt, et rarement contredit.
Même chose en santé : le système hospitalier encaisse, les généralistes désertent certaines zones, les délais s’allongent, les inégalités territoriales explosent. Plus de 11 % des Français vivent dans des zones sous-dotées, selon l’IRDES. Dans certains départements ruraux, le temps d’attente pour un dermatologue ou un cardiologue dépasse 40 jours. L’accès n’est plus garanti, même avec la carte Vitale.
Sur le marché du travail, la France affiche un taux de chômage stable autour de 7,5 %. Ce n’est ni catastrophique, ni rassurant. Le taux d’emploi progresse, mais reste plombé chez les seniors. Les quinquagénaires trop jeunes pour la retraite, trop âgés pour l’emploi, deviennent une variable oubliée. Et dans ce climat, les jeunes générations regardent l’avenir sans boussole. Travailler, oui, mais pourquoi ? Pour rembourser quoi ? Pour quel logement ? Pour quelle stabilité ?
Et c’est là que la fracture devient politique. Depuis les élections de 2024, l’Assemblée nationale est coupée en trois blocs irréconciliables. Aucun ne domine. Aucun ne fédère. La défiance s’est enracinée : seuls 23 % des Français disent faire confiance au gouvernement, 32 % à l’Union européenne. Et 62 % estiment que ce qui divise la société est plus fort que ce qui la rassemble. À ce stade, ce n’est plus un fossé. C’est une crevasse.
C’est dans ce contexte qu’intervient le pari dangereux de François Bayrou. Englué dans une crise économique et institutionnelle, il a choisi de soumettre son gouvernement à un vote de confiance. Un geste présenté comme démocratique, mais qui pourrait bien précipiter une issue dont lui-même ne contrôle plus les contours. Car si la confiance ne lui est pas accordée, c’est tout l’édifice qui tremble : chute de l’exécutif, formation d’un nouveau gouvernement, ou, plus risqué encore, une nouvelle dissolution. Rien ne dit que les Français souhaitent rejouer une partition qu’ils rejettent déjà. Mais rien n’indique non plus qu’ils accepteront de continuer ainsi.
Ce qui mine la France, ce n’est pas seulement une économie défaillante, un État obèse ou des services publics exsangues. C’est l’impossibilité de croire encore à un projet commun. C’est le règne de la dissonance : entre ceux qui n’ont plus rien à perdre et ceux qui ont peur de tout perdre. Entre les champions de la start-up nation et les invisibles des sous-préfectures. Entre ceux qui s’en sortent et ceux qu’on laisse sortir du système.
Il y a urgence, non pas à désigner un nouveau coupable, mais à inventer une voie. Et pour cela, il faudra plus qu’un ajustement comptable. Il faudra de la parole politique qui fasse sens. Il faudra du courage. Et surtout, il faudra un diagnostic partagé. Car une société qui ne sait plus ce qu’elle protège finit toujours par se déchirer.