
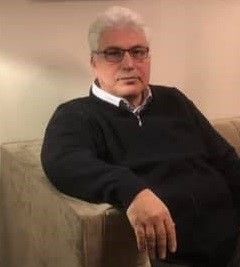
Antananarivo s’est éveillée cette semaine sous un autre ciel.
Des militaires y ont annoncé la prise du pouvoir après trois semaines de manifestations menées par la jeunesse connectée, cette génération Z qu’on disait distraite, indifférente, perdue dans ses écrans. Le président malgache s’est exilé à Dubaï, rapportait le journal Le Monde du jeudi 16 octobre 2025. Pour la première fois, la génération du numérique a produit une conséquence historique tangible, une onde de choc que les capitales du Sud commencent à ressentir, de Rabat à Katmandou, de Dhaka à Colombo.
Ils ont grandi entre un ciel de poussière et un écran bleu. Ils ont entre treize et vingt-huit ans, et partagent le même vertige : celui d’avoir hérité d’un monde sans promesse. Madagascar, Sri Lanka, Bangladesh, Népal, Maroc, n’ont en apparence rien en commun, sinon l’écho d’une jeunesse qui gronde, qui se cabre contre la fatalité. L’école n’enseigne plus l’avenir, la politique ne garantit plus la dignité, et le marché mondial, comme une mer trop vaste, ne laisse place qu’aux naufragés.
Cette génération n’a pas connu la lenteur ni l’attente. Elle s’est formée à la vitesse du clic, nourrie par les écrans, façonnée par l’instantané. Là où leurs aînés rêvaient d’exil, eux rêvent d’expression. Ils ne fuient pas : ils publient, commentent, s’indignent, et transforment le réseau en agora.
La fin des médiations
Ce qui les unit, c’est une même méfiance, lucide et tenace. Les institutions qu’ils ont connues, à savoir l’école, le parti, l’État et le syndicat, ne leur parlent plus. Elles s’expriment dans une langue morte, verticale, qui n’épouse ni leur rythme ni leur colère. Alors ils tracent d’autres chemins, horizontaux, mouvants, éphémères. Les communautés virtuelles remplacent les structures formelles, les influenceurs deviennent tribuns, et les luttes se propagent comme des incendies sans centre.
Brigitte Prot, dans Génération Z. Libérer le désir d’apprendre, l’avait pressenti : « Nous entrons dans un monde horizontal où la verticalité éducative a quitté la place. » Ce monde sans hauteur, ces jeunes l’habitent avec naturel. Ils refusent la parole d’en haut et réclament la parole partagée. Ce n’est plus le temps des porte-voix, mais celui des échos.
La fracture du temps
Dans les rues de Colombo ou de Casablanca, un même cri s’élève : maintenant. Le temps long de la patience politique s’est dissous dans le temps court de la connexion. La minute vaut plus que le mandat, le message plus que le discours. Dans cette condensation du temps s’exprime une urgence à vivre, non à attendre.
L’immédiateté libère, mais elle isole. Elle dilue la mémoire, épuise l’attention, rend la révolte fugace. Le futur, ils n’y croient plus ; le passé, ils ne s’en réclament pas. Ils avancent dans le temps comme on avance dans une rue en ruine, cherchant une porte ouverte sur le jour.
Les illusions du progrès
Ces jeunes ont grandi dans la promesse d’un monde ouvert : mobilité, innovation, réussite sans frontière. Mais l’ouverture s’est refermée sur eux. Le passeport du Sud vaut moins qu’un abonnement à Netflix. Les ONG, les bailleurs, les experts venus d’ailleurs leur parlent de développement durable pendant que la vie, chez eux, demeure durablement précaire.
Leur révolte naît de cette dissonance. Elle ne réclame pas de nouveaux maîtres, mais la reconnaissance d’une humanité partagée. Ce qu’ils refusent, c’est la confiscation du possible. Ils n’acceptent plus que leur jeunesse soit décrite comme une « bombe sociale » ou un « risque migratoire ». Ils veulent être la réponse, non le problème.
Un monde horizontal
La génération Z du Sud vit sans repères verticaux. Elle ne s’incline ni devant l’État, ni devant le professeur, ni devant le père.
Là où la génération X cherchait l’emploi, celle-ci cherche la cause. Elle s’engage dans l’écologie, la justice numérique, la défense des droits. Ses armes : le smartphone, la vidéo, la dérision. Un tweet devient pamphlet, un hashtag manifeste. Ce n’est plus l’époque des barricades, mais des flux. L’onde remplace la pierre, et dans chaque onde demeure un visage, celui d’un jeune qui refuse de s’effacer.
La nouvelle solitude
Sous l’effervescence, ces adolescents hyperconnectés se découvrent seuls dans la foule numérique. L’écran, miroir sans profondeur, leur renvoie une image morcelée. L’amitié devient notification, l’amour se compte en vues, la reconnaissance s’obtient par le nombre de followers.
Pourtant, dans le vacarme des clics, certains apprennent à lire autrement le silence. C’est là que naît leur salut : dans le retour au réel. On le voit dans les villages du Haut Atlas, où des jeunes filment les traditions menacées ; à Antananarivo, où d’autres montent des ateliers d’art pour les enfants des rues ; à Katmandou, où le népalais s’allie à l’anglais pour écrire des poèmes en ligne. Le numérique, instrument de fuite, devient parfois lieu de racine.
De l’élève au citoyen
Leur combat commence souvent à l’école. Non contre elle, mais contre ce qu’elle n’enseigne plus : la dignité du savoir. Comme le souligne Brigitte Prot, « le désir d’apprendre obéit à des lois inédites ». Ces jeunes ne veulent plus accumuler des connaissances, ils veulent comprendre le monde. Là où le modèle ancien formait des sujets dociles, ils réclament une pédagogie de la réciprocité.
L’école du Sud vacille entre archaïsme et injonction numérique. Elle exige des résultats sans offrir de sens, distribue des diplômes sans horizon. Alors la jeunesse se détourne, non par paresse, mais par lucidité. Ce n’est pas l’ignorance qui les menace, c’est l’inutilité. L’éducation, pour eux, ne vaut que si elle libère, si elle sert à nommer le monde plutôt qu’à s’y soumettre.
L’esprit de la désobéissance
Chaque époque enfante sa manière de résister. Celle-ci a choisi la dérision. Le rire, chez eux, est une arme politique. Dans ce théâtre numérique, la jeunesse du Sud met en scène l’absurde : le fonctionnaire corrompu, l’électricité absente, l’école fermée. Le rire devient un acte de souveraineté.
Mais derrière cette ironie veille une éthique. Ils ne veulent plus seulement dénoncer, ils veulent comprendre. Ils s’informent, traduisent, débattent, franchissent les frontières invisibles. La mondialisation qu’ils subissent, ils la transforment en espace de circulation. Le monde, ils le connaissent sans visa.
Les capitales en ébullition
Ces mouvements ne sont pas coordonnés, mais ils se répondent. Une génération globale, née du Sud, invente une conscience planétaire. Elle ne s’appuie ni sur les idéologies du passé ni sur les modèles importés. Elle forge son propre langage, à la mesure du présent.
Sous leurs doigts défile le monde entier. Le réel, pour eux, n’est plus un décor mais un combat. Ils pressentent que la virtualité, si elle n’est pas habitée par le sens, finit par dissoudre la vérité. Alors ils redescendent vers le tangible : la rue, la communauté, la nature, la main tendue.
La génération Z du Sud est peut-être la première à comprendre que l’avenir ne viendra pas d’en haut. Qu’aucun sauveur, aucune institution, aucun marché ne réparera le monde. Elle sait que l’histoire ne s’écrit plus en chapitres, mais en impulsions. Leur insurrection est d’abord celle du réel contre l’illusion.
Un nouveau commencement
Il y a dans cette jeunesse quelque chose de l’aube et du crépuscule mêlés. Elle marche dans les ruines d’un monde qui se défait, mais elle y cherche la lumière. Ses révoltes ne sont pas seulement politiques, elles sont métaphysiques : elles disent le besoin d’un sens à la vie, d’une dignité partagée, d’un avenir où l’homme ne sera plus réduit à une donnée.
Le Sud, longtemps perçu comme périphérie, devient le laboratoire de l’humain. Et ces jeunes, souvent méprisés, sont les premiers explorateurs d’un réel reconquis. Ils ne réclament pas le pouvoir : ils réclament la parole. Leur cri n’est pas une plainte, mais une promesse. Leur révolution n’est pas celle du bruit, mais celle du sens, patiente et irréversible.





