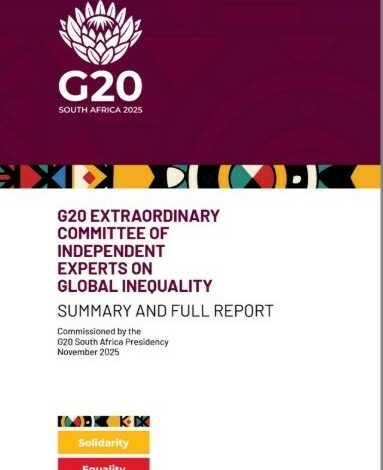
Quand la fortune des uns creuse la faim des autres
Par Jamel BENJEMIA
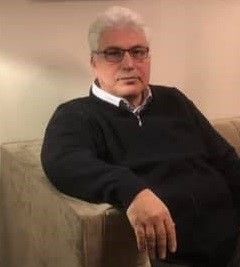
Il est des rapports qui ne se lisent pas comme des études mais comme des miroirs. Celui que le G20 consacre aux inégalités appartient à cette espèce rare : derrière les tableaux chiffrés, on y entend la rumeur d’un monde fracturé, la plainte des oubliés, le vertige d’une prospérité devenue abstraction. Sous le vernis des pourcentages, c’est l’histoire d’une humanité qui s’évalue à la balance de ses écarts et qui, peut-être, commence à douter de ce qu’elle pèse encore d’humain.
Le rapport dirigé par le prix Nobel Joseph Stiglitz s’ouvre comme une autopsie du siècle : le corps du monde y gît, disloqué par ses propres écarts.
83 % des pays affichent un coefficient de Gini supérieur à 0,4, signe d’une fracture qui n’est plus sociale mais structurelle.
Le 1 % le plus riche a capté 40 % de la richesse produite depuis l’an 2000, tandis que la moitié de l’humanité n’en a reçu qu’un seul pour cent. Ces chiffres, austères en apparence, sont des plaies ouvertes : ils révèlent une vérité que les puissants feignent d’ignorer.
L’inégalité n’est plus un accident de parcours, mais le moteur même de l’économie mondiale. La richesse s’est muée en forteresse, la pauvreté en frontière. Là où s’accumule le capital, le pouvoir s’installe ; là où il manque, la dignité s’effrite. Ce déséquilibre n’a rien de naturel : il est le produit d’une domestication du monde par les marchés, d’une croyance obstinée selon laquelle le profit serait la langue universelle du progrès.
Le règne de la rente
Au fil des pages, les experts du G20 reconnaissent que le travail n’est plus la mesure de la richesse.
Dans plus de la moitié des pays, la part du revenu allant au capital s’accroît tandis que celle du travail décline. On ne récompense plus l’effort mais la détention, non la création mais la spéculation.
L’économie s’est détachée de la main qui produit pour glorifier celle qui possède. Ce glissement a corrompu le contrat social.
La réussite devient privilège héréditaire, l’entreprise devient empire. Les fortunes se transmettent désormais plus vite qu’elles ne se créent : mille milliardaires s’apprêtent à léguer cinq mille milliards de dollars à leurs héritiers, presque sans impôt. Le capital est devenu immortel, les pauvres, eux, continuent de mourir jeunes. La dérégulation des marchés, la privatisation des biens publics, la baisse de l’impôt sur les sociétés, la montée des taxes sur la consommation : autant de lois scélérates qui ont déplacé le poids de l’effort vers ceux qui n’ont rien et sanctifié ceux qui ont tout.
L’ombre portée du centralisme
Si le rapport établit le diagnostic, il reste prisonnier de sa verticalité. Il imagine la réparation depuis les sommets, comme si la guérison devait venir des institutions qui ont contribué au mal.
L’idée d’un International Panel on Inequality en est le symbole : l’intention est noble, mais la démarche ignore le réel. La misère ne se combat pas depuis les balcons du pouvoir mondial, mais à hauteur de visage. Ce centralisme tue l’initiative locale, étouffe la créativité sociale, réduit les peuples à des variables. Une humanité administrée depuis le centre perd le goût de se penser depuis la périphérie. La véritable guérison naîtrait des territoires, des coopératives, des associations, des communautés qui, chaque jour, réinventent la dignité par le partage et la connaissance.
La démocratie en sursis
L’inégalité fracture le pouvoir avant de fracturer les revenus. Dans les pays aux écarts extrêmes, le risque de dérive autoritaire est sept fois plus élevé. Là où la richesse se concentre, la parole se confisque, le sens se monnaie. Les médias, les lois, les campagnes électorales finissent par servir ceux qui peuvent les acheter. La misère n’exclut plus seulement, elle efface.
Dans une société où tout s’achète, la liberté devient une monnaie : ceux qui n’en ont pas sont condamnés au silence. L’inégalité détruit la confiance, et sans confiance, aucune démocratie ne survit.
Le faux universalisme du marché
La mondialisation avait promis l’abondance. Elle a produit la dépendance. Les pays du Sud ont exporté leurs ressources et importé leur manque. La finance, les brevets, les arbitrages privés entre investisseurs et États ont formé une cage dorée où l’économie réelle s’est lentement asphyxiée. La pandémie a révélé la cruauté de ce modèle : les vaccins se distribuaient selon le PIB, non selon la souffrance. La crise climatique enfonce le clou : les plus frappés sont ceux qui n’ont presque rien émis. Le marché n’est pas universel. Il n’est qu’une idée particulière prétendant valoir pour tous.
Vers un humanisme de la répartition
Le monde n’a pas besoin d’une croissance infinie mais d’une respiration juste. La prospérité n’est pas la vitesse de l’accumulation, mais la qualité du partage. Réinventer la répartition, c’est rendre à la richesse son sens : circuler. Cela exige du courage : désobéir aux dogmes, préférer la justice à la performance, la dignité à la dette. Les sociétés qui l’oseront n’y perdront pas leur prospérité : elles y retrouveront leur âme.
La mesure des âmes
Peut-être retiendra-t-on que le XXIᵉ siècle fut celui où la richesse triompha de la raison avant d’être renversée par la nécessité. Car l’excès est une forme de ruine, et l’injustice, une fatigue du monde.
Les civilisations ne s’effondrent pas de pauvreté mais d’indifférence. Viendra le jour où la liberté d’un enfant affamé pèsera plus lourd que la fortune d’un fonds d’investissement. Ce jour-là, l’humanité aura franchi le seuil qui sépare la puissance de la grandeur. Tant que le monde comptera ses fortunes avant ses enfants, il ne connaîtra ni paix, ni dignité, ni avenir.





