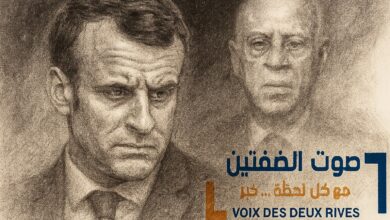Nizar jlidi écrit :Assemblée tunisienne : ça parle fort, ça travaille peu


Au moment d’examiner le budget 2026 de la Tunisie, l’Assemblée des représentants du peuple retrouve ses vieux réflexes : indignations en direct, escarmouches personnelles, déclarations à l’emporte-pièce. À l’heure des arbitrages lourds, elle débat pour la forme, puis valide sans nuance. Après dix ans d’excès de l’ancienne scène parlementaire, la leçon n’a manifestement pas été retenue.
On dit souvent que la Tunisie n’a pas eu la classe politique qu’elle méritait. Le spectacle offert depuis plusieurs jours autour du budget 2026 en fournit une preuve supplémentaire : face à une crise économique profonde, les élus multiplient les tirades sur l’avenir du pays, mais peinent à produire le moindre texte structurant. La décennie 2011-2021 avait pourtant servi d’avertissement : excès oratoires, agressions en séance, paralysie chronique, marchandages stériles.
La nouvelle architecture institutionnelle a remis le pouvoir législatif à sa place normale : examiner, auditionner, voter. Ce n’est pas en soi un problème. Le vrai malaise réside ailleurs : dans l’incapacité des groupes parlementaires à assumer les tâches qui leur reviennent encore, notamment la modernisation des grands textes. Rien n’y fait : l’essentiel du travail se concentre sur l’exhibition des humeurs des députés, tandis que la discussion technique sombre dans le bavardage.
Or le moment commande autre chose. Le pays traverse un choc financier immense, nourri par des besoins d’emprunt à deux chiffres et un système bancaire qui absorbe une part croissante du financement public. Dans cette équation délicate, le rôle de l’Assemblée devrait être clair : documenter, questionner, amender. Elle préfère les apartés en séance, les vidéos calculées et la joute personnelle.
Ce n’est pas qu’une question d’esthétique. C’est un déficit de responsabilité.
Une scène qui s’agite, puis s’incline
Les séances publiques du Parlement tunisien consacrées au budget 2026 auront offert un concentré de tout ce que l’on croyait avoir laissé derrière nous. Les échanges houleux entre députés, les invectives filmées au téléphone, les tirades solitaires à forte portée virale rappellent les heures grises où la télévision retransmettait des brouhahas sans fin, nourrissant la défiance du public et préparant, sans que personne ne l’avoue, l’effondrement du système parlementaire par lassitude populaire.
Rien n’a changé, ou presque. On s’indigne, on accuse, on met en scène des antagonismes pour rappeler sa présence sur les réseaux sociaux, puis, quelques heures plus tard, on appuie sur le même bouton que les autres : adopter le texte venu du gouvernement. Il serait excessif de demander au Parlement de produire un projet économique complet. Mais l’on serait en droit d’exiger qu’il mobilise au moins son énergie pour discuter du fond.
Le fil est toujours le même. On feint la rupture, puis on revient dans le rang. Résultat : un exercice réduit à un rituel où chacun sauve la face, mais où rien ne s’écrit vraiment.
L’ombre d’hier et les occasions manquées
La décennie 2011-2021 avait offert une chance rare : réécrire les règles du jeu, rétablir la confiance et construire une culture parlementaire solide. À la place, le pays a vu s’installer un théâtre permanent fait de coups d’éclat, de joutes creuses et d’alliances instables (corrompues ?). Les scènes de confrontation en commission, les invectives en séance et les blocages interminables ont dilué la fonction même de représenter. La population en est sortie fatiguée, méfiante, prête à tourner la page.
Cette histoire relativement récente aurait pu servir de socle. Elle n’a laissé qu’un réflexe : occuper le terrain symbolique, sans bâtir le moindre chantier durable. La preuve est sous les yeux : alors que la Tunisie vit une phase institutionnelle où le gouvernement porte l’essentiel de l’initiative législative, l’Assemblée pourrait compenser par la qualité de son travail. Elle ne le fait pas.
Les dossiers les plus structurants restent en attente. La mise à jour du code pénal, annoncée depuis des années, patine. La codification des décrets et lois organiques traîne, si bien que le citoyen peine à comprendre ce qui est encore en vigueur. Les textes civils et procéduraux mériteraient d’être harmonisés avec la Constitution de 2022 ; personne ne s’y attelle avec sérieux.
L’excuse la plus commode consiste à répéter que l’essentiel se décide par le pouvoir exécutif, et que l’Assemblée ne peut que suivre. C’est une lecture commode, mais fausse. Rien n’empêche les députés d’utiliser leurs prérogatives restantes pour proposer, pour encadrer, pour éclairer. Ils pourraient mobiliser leur expertise juridique, exiger un débat rigoureux sur les grands équilibres financiers, ou prendre en main la modernisation des textes qui structurent le quotidien des Tunisiens. Rien de tout cela n’advient.
Au lieu de cela, le Parlement recule vers un rôle secondaire qu’il semble accepter avec soulagement. Il s’abrite derrière l’urgence économique pour justifier son inertie et se contenter de valider des lois qu’il n’a pas contribué à façonner.
Le souvenir de l’ancien régime parlementaire devrait inciter à la prudence. Il ne fait que rappeler la tentation du bruit et l’absence de réforme. Dix ans ont suffi pour montrer que le vacarme ne remplace ni le travail ni la vision. Et pourtant, la même logique revient : l’hémicycle sert de scène, non d’atelier.
Un Parlement qui discute de tout… sauf de ce qui compte
Dans l’hémicycle, les conversations prennent souvent l’allure de confidences publiques : anecdotes, indignations, slogans, puis silence quand viennent les chiffres et les mécanismes. La séquence du budget 2026 en offre un condensé frappant. Les députés s’attardent sur des polémiques secondaires, mais passent rapidement sur les questions de fond : qui finance le budget de l’Etat, à quel coût, et avec quelles conséquences pour l’économie réelle ?
Le cœur du sujet est pourtant simple : la Tunisie continue de se financer davantage sur le marché domestique, avec un rôle croissant joué par le système bancaire national et des avances directes de la Banque centrale. Cette dynamique interroge. D’un côté, elle évite l’excès de dépendance vis-à-vis de partenaires étrangers. De l’autre, elle crée une forme de cercle fermé où l’Etat se finance auprès d’un secteur déjà peu enclin à nourrir l’économie productive. L’articulation entre banques commerciales et Banque centrale mérite un débat sérieux ; elle n’obtient qu’un survol poli.
Plus encore, les députés passent vite sur les enjeux énergétiques. La réduction des subventions n’est pas un choix comptable anodin : elle conditionne la facture future des ménages, la compétitivité industrielle et la stabilité sociale. On pourrait s’attendre à des projections, des scénarios, des propositions d’accompagnement. On se contente d’arguments généraux, parfois approximatifs, rarement étayés.
La question diplomatique, elle aussi, reste effleurée. La Tunisie se trouve à mi-chemin entre plusieurs cercles de coopération. Elle ne s’est pas engagée clairement dans la diversification de ses partenariats économiques, mais n’a pas non plus consolidé ceux qu’elle dit privilégier. Résultat : un message brouillé, qui laisse planer l’idée que la politique étrangère est gérée au fil des urgences. Ce flou complique la discussion sur les financements extérieurs, puisqu’il est difficile d’expliquer au citoyen avec qui l’on travaille, et sur quelle base… n’est-ce pas le rôle des élus ?
Le Parlement, dans cette configuration, pourrait jouer un rôle d’alignement. Il pourrait demander des comptes, auditionner les ministères, exiger des calendriers. Il pourrait même prendre l’initiative et proposer des lois qui stabilisent le cadre : fiscalité, incitations sectorielles, réforme bancaire. Rien de tout cela ne se déroule comme il le faudrait. Les interventions s’appliquent surtout à commenter la météo économique, sans proposer le moindre outil pour l’améliorer.
Cette distance entre discours et production n’est pas seulement problématique sur le plan institutionnel. Elle empêche le pays de disposer d’un espace législatif mature, capable d’accompagner une sortie de crise.
Une responsabilité qui se dilue
Il serait trop facile de penser que la scène actuelle n’est qu’un dérapage passager. En réalité, elle prolonge une décennie d’habitudes qui ont solidement enraciné l’irresponsabilité politique comme méthode de travail. Entre 2011 et 2021, le pays a déjà vu son Parlement se transformer en théâtre, où l’on se battait pour les micros plutôt que pour les idées. La conséquence fut lourde : la confiance s’est effondrée, l’économie a ralenti, et les institutions ont fini par s’écrouler sous le poids du ridicule.
L’histoire aurait pu servir de leçon. Elle n’a servi qu’à produire une nouvelle génération de commentateurs installés dans les fauteuils de la représentation nationale.Ils parlent fort, mais portent peu.Ils dénoncent, parfois à raison, mais proposent rarement — ou jamais.
Lors des discussions sur la loi de finances, ce mécanisme est apparu au grand jour. On s’est offusqué, parfois même avec talent, mais personne n’a réellement pris la responsabilité d’assumer une position structurée. Aucune proposition alternative, aucun amendement sérieux, aucune tentative de dresser un cap.Juste des mots, et un vote paradoxalement acquis d’avance.
Les fractures internes, elles, ne sont même plus idéologiques mais claniques, personnelles, souvent superficielles.Le différend entre Ahmed Saïdani et Mohsen Marzouk, par exemple, relève davantage de l’invective que de la politique.Celui entre Fatma Mseddi et Syrine Mrabet tient plus du commentaire de vestiaire que du débat parlementaire.Tout cela se déroule dans un pays où l’inflation use les ménages, où les entreprises cherchent un cadre fiscal prévisible et où la question du financement devient vitale.
Ce contraste dit tout. La Tunisie affronte sa crise la plus grave depuis l’indépendance.Le Parlement, lui, se chamaille.
On pourrait espérer que les élus – sans parler de la classe politique en général – compensent l’absence de maturité de certains débats en travaillant ailleurs : en commission, en proposant des réformes de fond, en exigeant l’application des dispositions de la Constitution. Mais là encore, le silence domine.Les textes prioritaires restent en suspens.Le code pénal attend.La modernisation du droit civil patiente.L’harmonisation des procédures n’avance pas.
On en revient à une question simple, que beaucoup n’osent plus poser :si l’Assemblée ne légifère pas, à quoi sert-elle ?Certains députés semblent avoir déjà la réponse : elle sert à être vue.À se positionner pour l’inconnu, à occuper le terrain au cas où, demain, le vent tournerait.C’est sans doute là l’ironie la plus inquiétante :au moment même où l’histoire réclame du courage réaliste, le jeu politique s’organise autour de la prudence opportuniste.
La Tunisie n’est pas un pays léger.Elle a traversé des crises politiques, financières, sociales, et tient encore debout par une combinaison de résilience populaire, institutionnelle et de sens du réel.Rien, dans son histoire récente, ne ressemble à une fuite en avant.
Ce qui surprend — et inquiète —, c’est que l’un des rares espaces où la gravité devrait s’imposer est devenu un décor.
Le Parlement parle, s’écoute, se répond ; il ne construit pas.
Les députés dénoncent aujourd’hui ce qu’ils voteront demain.
Les querelles prennent la place des idées, les egos remplacent les programmes.
Le pays a besoin de solutions — le droit le rappelle, l’économie le crie.Mais l’Assemblée semble préférer l’agitation à la responsabilité.En refusant de tirer les leçons de la décennie passée, elle reproduit ses pires réflexes : l’improvisation, l’hostilité factice, les indignations sans lendemain.
Il ne s’agit pas d’idéaliser l’exécutif, ni de le dédouaner.Mais face à l’ampleur des défis, l’opposition parlementaire ne peut continuer à jouer au figurant.Elle doit travailler, proposer, contredire utilement, occuper enfin l’espace qui lui revient.La question, posée sans colère, reste ouverte :
la Tunisie a-t-elle la classe politique qu’elle mérite ?
Pour l’instant, la réponse s’écrit dans l’hémicycle —et elle n’est pas flatteuse.