Les Stablecoins ou la dollarisation 2.0
Le mot semble paisible, presque rassurant. Stablecoin, mot neuf gonflé de promesses, évoque une monnaie sans vertige, libérée des caprices du marché, tenue par la rigueur tranquille d’un code.

Les Stablecoins ou la dollarisation 2.0
Par Jamel BENJEMIA
Le mot semble paisible, presque rassurant. Stablecoin, mot neuf gonflé de promesses, évoque une monnaie sans vertige, libérée des caprices du marché, tenue par la rigueur tranquille d’un code.
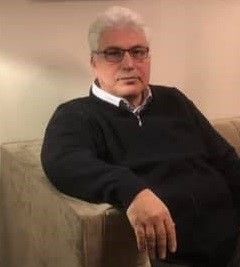
Mais la stabilité n’est jamais un état, seulement une respiration entre la confiance et la peur. Ces jetons numériques, que l’on présente comme la maturité financière de notre temps, reposent sur un vide : celui de la garantie publique.
« Leur solidité dépend d’un contrat privé, non d’une promesse d’État », rappelait l’économiste Éric Monnet dans le journal Le Monde du 19-20 octobre 2025. Leur sécurité n’est pas l’expression d’une souveraineté, mais la fiction d’un équilibre provisoire.
Dans les pays du Sud, où les monnaies s’épuisent, ces jetons deviennent des refuges. On y transfère le salaire d’un fils expatrié, on y protège une épargne fragile, on y loge ce qu’il reste de confiance. Le Stablecoin, miroir d’espérance, paraît incorruptible. Pourtant, ce havre numérique dissimule une dépossession lente.
À mesure que le billet vert se démultiplie en milliards d’unités numériques, les nations qui l’adoptent s’éloignent d’elles-mêmes. Ce ne sont plus leurs banques qui frappent la monnaie, mais des plateformes sans ancrage. Et, sans s’en apercevoir, elles abandonnent la clé de leur destin pour la commodité d’une application.
La stratégie du leurre
L’empire d’hier portait des uniformes ; celui d’aujourd’hui se dissimule dans les poches. Il ne conquiert plus, il convainc. Sous les atours séduisants de l’innovation, il parle la langue du progrès et, sous prétexte de simplifier la vie, redessine la carte du pouvoir.
La loi américaine « Genius Act », adoptée en 2025, n’a pas inventé le phénomène : elle l’a consacré. En encadrant les Stablecoins libellés en dollars, Washington a offert à sa devise un empire sans frontières, celui du numérique.
Chaque transaction indexée sur le dollar devient une lueur dans la sphère d’influence américaine.
Ce n’est plus la diplomatie des États, mais celle des flux. Une domination sans bruit ni armée, avançant sous le masque du service financier. Le dollar n’a plus besoin de s’imposer : il s’infiltre. Il ne gouverne plus par la force, mais par la fluidité. Et l’humanité, croyant s’émanciper, entre dans un empire de verre, celui de la monnaie privatisée, rendue docile par la promesse d’efficacité.
L’Europe, puissance lente
L’Europe regarde cette mutation avec la gravité d’un vieux continent conscient de ses lenteurs. L’eurodéputée Aurore Lalucq, présidente de la commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen, l’a formulé dans la même édition du journal Le Monde : « Renoncer à l’euro numérique, c’est renoncer à la souveraineté monétaire elle-même. »
Car la dépendance ne se mesure plus en dette, mais en infrastructures. Aujourd’hui déjà, 99 % des paiements européens transitent par des réseaux américains. Demain, si les Stablecoins s’imposent, l’euro deviendra convertible mais non souverain.
L’Europe, jadis forge de la monnaie moderne, voit son autorité s’éroder dans la fluidité d’un système qu’elle ne maîtrise plus. Elle débat de sécurité, d’éthique, de droit, pendant que le monde construit. La monnaie, naguère levier du politique, s’est muée en simple service technique. Ce n’est plus la puissance qui crée la confiance, mais la vitesse.
Et pendant que l’Amérique privatise la confiance, l’Europe continue de la réglementer, geste noble mais impuissant. La règle rassure sans protéger.
Le Sud, laboratoire de la dépossession
Dans les marchés de Lagos, de Bogota ou de Dacca, les Stablecoins se sont imposés sans décret ni violence. On les utilise parce qu’ils fonctionnent, là où les monnaies locales chancellent. Les diasporas s’en servent pour envoyer de l’argent, les États pour retarder l’effondrement de leur système de paiement.
Peu à peu s’installe une dépendance invisible, non plus subie mais intériorisée. Ce n’est plus la domination politique, c’est l’abdication monétaire. Les peuples confient leur avenir à des plateformes étrangères, croyant y trouver refuge.
Mais quand la monnaie n’appartient plus à la nation, tout vacille avec elle : la politique, la production, la confiance. Le code ne frappe pas, il remplace. Dans son silence logique, il efface la volonté des hommes.
L’euro numérique : un acte de mémoire
Face à cette mutation silencieuse, l’euro numérique apparaît comme un geste de résistance. Agnès Bénassy-Quéré, secrétaire générale adjointe au Trésor français, et François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, « ne parlent pas de modernisation, mais de continuité ».
L’euro numérique n’a pas vocation à concurrencer les cryptomonnaies ; il s’appuie sur le registre distribué, technologie jadis symbole d’anarchie, devenue le socle d’un ordre concerté.
Le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets, c’est-à-dire Règlement sur les marchés de cryptoactifs en français) en dessine les frontières : transparence, responsabilité, supervision. Loin des illusions libertariennes, il rappelle que la monnaie n’est pas un produit, mais une promesse. Elle ne vit que comme œuvre collective, car elle engage la parole d’un peuple.
Ainsi l’Europe tente de rendre à la finance abstraite une âme et à la modernité une morale, en apprivoisant la « tokénisation », cette alchimie nouvelle qui consiste à transposer un actif réel dans la clarté numérique d’une blockchain, et en cherchant avec le Sud les linéaments d’une souveraineté partagée.
La monnaie, miroir de la démocratie
Quand Aurore Lalucq affirme que « toucher à la monnaie, c’est toucher à la démocratie », elle ne fait pas image : elle énonce une vérité fondatrice. La monnaie, c’est la confiance rendue tangible, le « nous » rendu visible par le chiffre.
Les Stablecoins, en fractionnant cette confiance, détruisent ce qu’ils prétendent garantir. Chaque transaction devient un acte sans visage, chaque utilisateur un atome sans ancrage.
Une société qui délègue à des algorithmes la garde de sa valeur perd peu à peu la mémoire de sa propre mesure. La stabilité promise n’est qu’un présent figé, où l’histoire cesse de battre.
Pour une souveraineté augmentée
L’Europe détient la science, le Sud la vitalité. Entre ces deux forces s’esquisse une espérance : bâtir une souveraineté augmentée, une monnaie publique capable de respirer dans le monde numérique sans trahir son humanité.
Le registre distribué, longtemps perçu comme menace, peut devenir instrument d’équité, à condition que la main qui le gouverne reste celle du droit.
L’innovation, pour être féconde, doit se souvenir de la lenteur du sens. Le progrès n’a de valeur que s’il garde un visage.
L’ombre du code
Le péril des Stablecoins ne vient pas de leur volatilité, mais de leur séduction. Lorsqu’un peuple croit qu’un algorithme vaut mieux qu’un État, la souveraineté a déjà changé de camp.
La monnaie n’est pas un outil : c’est une mémoire vivante, une alliance entre les morts qui ont bâti la cité et les vivants qui la poursuivent. L’oublier, c’est livrer la démocratie à la froideur du calcul.
Entre le visage humain et le visage du code, il faudra choisir celui que nous voulons reconnaître demain. Car une monnaie n’est jamais neutre : elle dit le lien, la confiance, le destin collectif.
Et pour la Tunisie, l’enjeu ne relève plus du débat théorique. Il s’agit de préserver la souveraineté monétaire avant qu’elle ne se dissolve dans l’économie dématérialisée du monde.
Comme je l’écrivais dans le journal Le Temps du 9 juillet 2023, le dinar numérique n’est pas une fantaisie technologique, mais une exigence historique, un espoir capable de refonder notre système financier. Il redonnerait à la nation la maîtrise de ses échanges, sécuriserait les transferts de la diaspora, limiterait la dollarisation rampante et placerait la Tunisie dans le concert des États qui osent gouverner la technologie au lieu de la subir.
Le XXIᵉ siècle ne pardonnera pas aux nations qui auront tardé à défendre la valeur de leur propre sceau monétaire, cette empreinte par laquelle un peuple se reconnaît et se perpétue.
Il faut à la Tunisie un dinar numérique souverain, enraciné dans la confiance publique, adossé à la Banque centrale et porté par la volonté du peuple.
Alors seulement, la modernité cessera d’être un mirage pour redevenir un horizon : celui d’un pays capable de se réinventer sans se trahir, d’avancer vers le futur sans perdre la mémoire de son âme.





