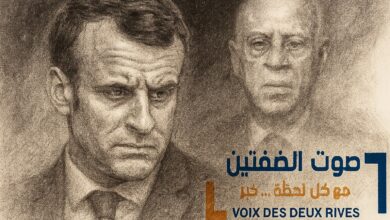Nizar jlidi écrit: Arabie saoudite–Etats-Unis : quand MBS met l’alliance à l’épreuve


En mai dernier, Donald Trump bouclait un tour du Golfe arabe (Qatar, Arabie saoudite, Émirats) et repartait avec des promesses d’investissements historiques, dont 600 milliards de dollars saoudiens aux États-Unis. Dans la foulée, Washington envoie des signaux d’ouverture envers le nouveau président et ancien terroriste syrien Ahmed al-Charaa. Depuis, Riyad teste ses marges — sur l’énergie, sur la Syrie, et dans son rapprochement avec l’Iran — pendant qu’un shutdown fragilise la Maison Blanche.
Le pacte américano-saoudien version 2025 n’a plus rien de sentimental : c’est une transaction froide. Le 13–16 mai, Trump visite Riyad après Doha et avant Abou Dhabi ; la Maison Blanche communique alors sur un engagement saoudien de 600 milliards de dollars d’investissements aux Etats-Unis, étalés sur une décennie, ciblant énergie, défense, technologies, minerais et infrastructures. Des notes d’instituts américains et des cabinets d’affaires détaillent une addition régionale dépassant les 2 000 milliards de dollars en engagements annoncés sur la séquence Golfe. Dans ce même tempo, Washington déverrouille politiquement le dossier syrien : rencontre Trump–al-Charaa au printemps, puis montée en gamme du statut du président-terroriste, à l’ONU, en pleine Assemblée générale — première présence d’un chef syrien à l’AGNU depuis 1967. Le message de Riyad est limpide : l’argent achète du levier, et le levier achète des inflexions.
Un pacte économique qui ressemble à un troc géopolitique
Le cœur du deal est chiffrable. 600 milliards de dollarsde l’Arabie saoudite promis sur sol américain, déclinés en investissements directs et co-entreprises dans les filières critiques (raffinage/pétrochimie avancée, munitions et composants, semi-conducteurs, chaînes de minerais critiques, logistique/ports, réseaux électriques). Ces engagements s’agrègent à un panier régional plus vaste — Qatar évoquait jusqu’à 1,2 trillion de dollars, les Emirats au-delà de 1,4 trillion sur dix ans — qui installe le Golfe comme financeur prioritaire de la réindustrialisation américaine et de ses chaînes d’approvisionnement. Pour Trump, c’est de l’emploi et des usines ; pour MBS, c’est un droit de regard sur les choix stratégiques de Washington.
Dans le même mouvement, le verrou syrien bouge. Au printemps, les signaux publics se multiplient : entretien Trump–al-Charaa, commentaires d’experts évoquant un soutien américain à une « normalisation sous conditions », visite d’Al-Charaa à New York en septembre avec la rhétorique d’un « Etat syrien unifié et stable ». On reste en deçà d’une reconnaissance formelle au sens juridique, mais l’acceptation de fait est lisible : cessation des anathèmes, canaux politiques rouverts, et validation implicite d’un nouvel équilibre voulu par Ben Salmane. Le troc se dessine : capitaux massifs contre desserrement de la ligne américaine au Levant.
Ce schéma révèle la méthode MBS : payer pour déplacer le centre de gravité. Les flux financiers achètent du temps et de la flexibilité à Washington ; en retour, Riyad gagne des garanties minimales (sur la Syrie), de la marge vis-à-vis d’Israël, et des appuis pour piloter l’OPEP+ avec le soutien dela Russie. C’est une alliance réécrite : moins d’allégeance, plus de conditionnalité — et un message sous-entendu à la Maison Blanche : « la fidélité saoudienne a un prix, et ce prix inclut nos priorités régionales ».
Washington paralysé : le shutdown comme révélateur de faiblesse
Alors que Riyad mettait en scène son rôle de partenaire incontournable de Washington, Donald Trump rentrait dans un pays à l’arrêt. Depuis fin septembre, l’administration fédérale vit au ralenti à cause d’un blocage budgétaire prolongé. Plus de deux millions de fonctionnaires connaissent des retards de salaire, certains secteurs comme l’aviation ou les parcs nationaux tournent au minimum, et plusieurs agences de sécurité travaillent sans financements garantis. Le Congrès, divisé, n’a pas réussi à s’entendre sur un texte de finances publiques, ce qui met Trump dans une posture délicate : obligé de gérer en même temps une impasse intérieure et des engagements internationaux lourds.
Dans ce contexte, les partenaires étrangers perçoivent un président absorbé par ses batailles internes. Les négociations avec les démocrates et une partie des républicains opposés à sa ligne budgétaire monopolisent son temps et son capital politique. Pour MBS, ce déséquilibre offre une fenêtre de tir : il sait que Trump a besoin de montrer des succès diplomatiques et économiques à son électorat. En multipliant les gestes spectaculaires – investissement massif aux Etats-Unis, ouverture vers l’Iran, rôle central sur la Syrie – le prince héritier teste la limite de la patience américaine.
Le shutdown agit donc comme un révélateur. Il montre que la machine institutionnelle américaine est vulnérable, et que la Maison Blanche est forcée de prioriser. La diplomatie saoudienne, elle, en profite pour avancer des dossiers qui, en temps normal, auraient rencontré plus de résistance de la part de Washington.
OPEP+ : une hausse calibrée qui envoie un message
En parallèle, la décision de l’Opep+ d’augmenter légèrement sa production, de l’ordre de 137 000 barils par jour, s’inscrit dans cette logique de bras de fer. Le geste est technique en apparence, mais politique dans sa portée. Depuis le printemps, les marchés s’attendaient à une stratégie de restriction pour maintenir les prix élevés. L’Arabie saoudite, au contraire, a choisi d’ouvrir un peu les vannes, en partie pour répondre aux pressions de grands importateurs asiatiques, mais aussi pour rappeler que la clé de l’équilibre pétrolier reste entre ses mains.
Cette augmentation, qui intervient après des mois de coordination étroite avec Moscou, ne bouleverse pas le marché mondial mais envoie un signal : l’Arabie saoudite peut décider d’agir sans se plier aux injonctions américaines. Pour Trump, qui compte sur une énergie relativement bon marché pour apaiser son électorat et contenir l’inflation, c’est un rappel que le robinet saoudien n’est pas automatique.
En choisissant ce timing, Riyad montre qu’il maîtrise à la fois la scène énergétique et la scène diplomatique. La convergence avec Moscou, le rapprochement avec Téhéran, et les milliards promis à Washington participent d’une même stratégie : multiplier les leviers pour peser sur chaque acteur, sans dépendre exclusivement d’aucun.
Le jeu qui se dessine n’est plus celui d’un suiveur cherchant l’ombre protectrice de Washington, mais d’un acteur régional conscient de son poids et décidé à en tirer parti. En multipliant les signaux d’indépendance – rapprochement inédit avec l’Iran, coordination assumée avec la Russie, augmentation calibrée de la production de l’Opep+ – Riyad envoie un message clair : les priorités américaines ne suffisent plus à dicter sa conduite. Le gouvernement paralysé de Trump accentue ce déséquilibre, donnant à MBS l’espace nécessaire pour tester jusqu’où il peut aller.
Ce qui se joue est donc moins une rupture immédiate qu’un ajustement stratégique : l’Arabie saoudite ne tourne pas le dos à Washington, mais elle rappelle que sa loyauté a un prix, et qu’elle dispose désormais d’alliés alternatifs. Dans ce bras de fer subtil, chaque geste saoudien devient une mise en garde : les Etats-Unis ne sont plus les seuls arbitres du Golfe arabe. Et ce contexte interviendra sans doute dans tous les dossiers diplomatiques au Moyen-Orient et en Asie occidentale.