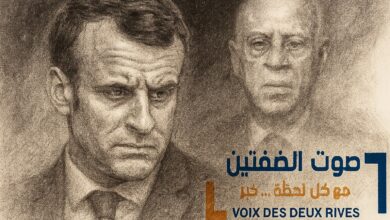Nizar Jlidi écrit /France : une République nullipare, un président isolé, un peuple à bout


Sans Premier ministre opérationnel ni budget 2026, l’exécutif français s’enfonce dans une crise politique et financière qui inquiète marchés et partenaires européens, notamment. Les Français réclament massivement une sortie nette — dissolution ou reset institutionnel — tandis que l’année blanche budgétaire plane comme un scénario de secours aux lourdes conséquences.
En France, où l’on votait jadis les finances publiques comme un rituel républicain, l’exercice est désormais suspendu à une équation impossible : pas de majorité, pas de cap, et un calendrier budgétaire qui se délite. La démission express de Sébastien Lecornu a encore rétréci la marge de manœuvre. Trois constats s’imposent. D’abord, l’opinion a basculé : le jugement est sévère, et l’attente d’un déblocage net domine. Ensuite, les marchés regardent la France comme un émetteur devenu politique avant d’être économique. Enfin, faute d’accord parlementaire, la mécanique de secours — les fameux douzièmes provisoires — pourrait s’imposer, au prix d’un affaissement de l’image et d’effets collatéraux bien réels sur l’activité et le crédit domestiques.
Comment la France en est arrivée là
La séquence est connue, mais ses effets convergent. À l’Assemblée française, aucune coalition stable ne s’est formée depuis la dissolution de sa prédécesseuse de 2024 ; l’exécutif a valsé de combinaisons précaires en solutions provisoires jusqu’au décrochage de ces dernières semaines. Dans l’opinion, un palier a été franchi : 3 Français sur 4 estiment que Sébastien Lecornu a eu raison de partir, signe qu’ils ne voient plus de sortie dans le bricolage institutionnel d’Emmanuel Macron.
Cette lassitude nourrit une demande de tranchant : 66 % souhaitent désormais une dissolution et un retour aux urnes à court terme — un niveau en hausse continue depuis juin. Dans le détail, le « oui, tout à fait » progresse à 39 %, marque d’un désir de clôture plus que de compromis introuvables.
La même photographie d’ensemble ressort côté climat politique : 82 % décrivent une situation « sans issue », ce qui n’est pas seulement de la défiance — c’est l’idée que le système, tel qu’il tourne, ne produira pas de budget ni de trajectoire lisible. Dans ce contexte, la « tentation technicienne » gagne du terrain : une majorité relative se dit prête à un chef de gouvernement « issu de la société civile », signe d’un pari sur la compétence et la neutralité perçues plutôt que sur des partis incapables d’additionner leurs voix.
Sur le plan procédural, l’horloge budgétaire aggrave tout. Faute de texte adopté d’ici le 31 décembre, l’État français basculerait sur des crédits mensuels calqués sur 2025 — les douzièmes provisoires — qui permettent de payer les salaires et de lever l’impôt, mais qui bloquent toute nouvelle politique et donnent l’image d’un pays en pilotage dégradé. Les ménages le sentent déjà : durcissement attendu des conditions de crédit, épargne de précaution élevée, consommation fragilisée ; côté entreprises, un coût de financement plus lourd et des reports d’investissement s’annoncent. Le politique et le financier se bouclent : tant que l’horizon institutionnel reste opaque, la prime de risque s’épaissit — et chaque jour sans compromis rend plus probable le recours à la procédure d’exception. Dans cet entonnoir, une chose est sûre : le statu quo ne finance pas un budget. Les chiffres d’opinion disent le reste — l’option préférée des Français n’est plus le colmatage, c’est la remise à plat.
Les expédients budgétaires : bricolage ou bombe à retardement ?
Faute d’accord politique, la Constitution et la pratique offrent à l’exécutif une roue de secours : la loi dite des « 12/12èmes ». Ce mécanisme revient à découper le budget précédent en tranches mensuelles et à autoriser leur exécution par un vote technique. Concrètement, cela permet à l’État de continuer à payer les fonctionnaires, les retraites, les dépenses incompressibles et à percevoir l’impôt. En apparence, c’est la garantie d’éviter un blocage total de la machine administrative. Mais ce système ne règle rien : il fige les choix de l’année passée et interdit toute politique nouvelle.
En 2026, appliquer le budget 2025 reviendrait à ignorer l’inflation, actuellement de 1,5 %. Cela entraîne mécaniquement une baisse relative des dépenses publiques et une économie forcée estimée à environ 10 milliards d’euros. Certains y verront un ajustement bienvenu pour les comptes publics. Mais, dans le même temps, le gel du barème de l’impôt sur le revenu fait mécaniquement entrer de nouveaux foyers fiscaux dans la contribution : on parlait de plus de 600 000 contribuables supplémentaires l’an dernier. Autrement dit, des ménages modestes, à peine revalorisés par l’inflation salariale, risquent de basculer vers l’imposition, accentuant le sentiment d’injustice sociale.
Les prestations sociales, elles, continueraient d’évoluer automatiquement avec l’inflation, comme le Smic ou les retraites. Mais sans cap budgétaire nouveau, aucune réforme ne peut être financée, qu’il s’agisse de l’école, de la santé ou de la transition énergétique. Le « statu quo budgétaire » devient un appauvrissement progressif de l’action publique. Qui plus est, la « droitisation » de la classe politique empêche toute réflexion, même hypothétique, sur la taxation des plus riches.
Les économistes soulignent aussi un autre risque : le bricolage budgétaire envoie un signal désastreux aux marchés financiers. Déjà, les taux d’intérêt sur la dette française grimpent. Chaque dixième de point coûte des milliards supplémentaires de charges. La perspective d’une gestion par 12/12èmes – perçue comme le symptôme d’un système politique bloqué – ne peut qu’alimenter cette défiance.
Les marchés et la sanction des agences
Depuis plusieurs semaines, les investisseurs scrutent la situation française avec inquiétude. L’absence de gouvernement stable et, surtout, l’impossibilité de voter un budget crédible agitent la sphère financière. Le lundi suivant la démission de Sébastien Lecornu, les taux d’emprunt à dix ans de la France ont bondi, dépassant 3,6 %, contre 3,2 % quelques semaines plus tôt. Derrière ces décimales, un effet boule de neige : chaque hausse d’un demi-point se traduit par plusieurs milliards supplémentaires en charge annuelle de la dette, dans un pays où l’encours frôle désormais 3 200 milliards d’euros.
Les agences de notation n’attendent pas la fin du bras de fer parlementaire pour adresser des avertissements. Moody’s et Standard &Poor’s devraient publier d’ici la fin octobre un nouvel avis, et tous les analystes anticipent une dégradation de la note française. Une telle décision ne serait pas anodine : la France, encore perçue comme une valeur refuge relative dans la zone euro, risquerait d’être rétrogradée dans la catégorie des pays à risque budgétaire. Le signal envoyé aux marchés serait alors clair : l’instabilité politique hexagonale n’est plus un simple bruit de fond, mais une donnée structurelle.
Ces signaux financiers pèsent déjà sur l’économie réelle. Les banques ralentissent la distribution de crédits immobiliers : elles rechignent à s’engager sur vingt ou vingt-cinq ans à taux fixes dans un contexte où l’Etat lui-même n’inspire plus confiance. Les ménages épargnent davantage – le taux d’épargne a atteint 19 %, un record en Europe – ce qui se traduit par moins de consommation et donc moins de croissance. Les économistes évoquent déjà 69 000 faillites d’entreprises attendues cette année, du jamais vu depuis la crise de 2008.
Le climat politique alimente ainsi une mécanique d’auto-aggravation : plus le blocage perdure, plus le coût du crédit augmente, plus l’activité se contracte, et plus la France s’isole dans une zone euro où l’Espagne, l’Italie et le Portugal affichent des trajectoires de croissance plus dynamiques, une relative stabilité politique et une meilleure image à l’international.
Recombinaisons politiques et scénarios d’issue
La démission expresse de Sébastien Lecornu a ouvert une séquence politique inédite. En vingt-sept jours à Matignon, il n’aura pas eu le temps de présenter un budget ni de bâtir une majorité. Son départ a déclenché une pluie de réactions qui esquissent déjà les prochains rapports de force.
À gauche, Jean-Luc Mélenchon a saisi l’occasion pour remettre sur la table la motion de destitution d’Emmanuel Macron. Pour le leader insoumis, l’impasse ne réside pas seulement dans la recherche d’un Premier ministre introuvable, mais dans la présidence elle-même, incapable d’assumer les résultats des législatives de 2024. Dans son blog comme dans ses interventions, il martèle que « le retour au peuple est la seule issue », estimant que l’institution présidentielle a perdu toute légitimité.
À l’autre extrême du spectre, Jordan Bardella a choisi une posture plus plate : fort d’enquêtes d’opinion qui placent son parti au seuil de la majorité absolue, il se dit prêt à « tendre la main » à une partie des Républicains pour bâtir une coalition de gouvernement. Cette ouverture vise à rassurer « les électeurs » et les « milieux économiques », en affichant un RN capable de composer plutôt que de cliver.
Du côté des macronistes et de leurs alliés résiduels, la stratégie reste floue. Emmanuel Macron s’accroche à la Constitution et tente de gagner du temps, en demandant à Lecornu de préparer une « plateforme d’action » malgré sa démission. Mais cette méthode donne l’image d’un exécutif figé, plus soucieux de sauver les apparences que de reconstruire une majorité opérationnelle. Les socialistes, eux, se tiennent à distance : ouverts à des compromis ponctuels mais refusant d’entrer dans un gouvernement qui appliquerait une politique contraire à leur programme.
Ces recompositions s’inscrivent dans un climat d’opinion défavorable au président. Selon les enquêtes publiées depuis le 6 octobre, une large majorité de Français estime que la situation ne peut pas durer sans dissolution. L’électorat paraît prêt à arbitrer, quitte à renforcer les extrêmes. Les sondages montrent aussi que le crédit accordé aux macronistes s’effrite au profit des forces qui apparaissent comme des alternatives claires – RN d’un côté, NFP de l’autre.
Dans ce contexte, plusieurs scénarios se dessinent : une dissolution rapide qui redistribuerait les cartes avant la fin de l’année, un gouvernement technique adossé au système des douzièmes provisoires pour gagner du temps, ou, hypothèse moins probable mais évoquée dans certains cercles, une crise institutionnelle ouverte avec mise en cause directe de la présidence. Aucun de ces chemins ne garantit la stabilité, mais tous rappellent que la 5e République vit peut-être l’un de ses moments les plus critiques depuis 1958. Une dernière hypothèse, avancée par des cercles proches de l’Elysée, mentionne l’ancien ministre de l’Economie Pierre Moscovici, comme le prochain Premier ministre. Proche des européistes des deux extrêmes, et ancienne figure du parti socialiste, Moscovici pourrait bien scinder les fronts politiques actuels et permettre à Macron de se maintenir au pouvoir pendant quelques mois. Dans tous les cas, rien qui pourrait changer les perspectives moroses de l’Etat français.
La démission éclair de Sébastien Lecornu n’est pas qu’un nouvel épisode de la valse des Premiers ministres : elle marque une rupture dans la capacité de l’exécutif français à gouverner. Sans budget, la France se retrouve exposée à la défiance des marchés, à la menace d’une dégradation financière et à un décrochage durable vis-à-vis de ses partenaires européens. Mais la crise est d’abord politique : elle révèle l’incapacité du macronisme à recomposer des alliances durables et l’érosion de la légitimité présidentielle.
Dans un pays où trois gouvernements sont tombés en un an, la question n’est plus seulement de savoir qui occupera Matignon, mais qui incarne encore la possibilité d’un cap collectif. L’opinion, lasse de cette instabilité, semble prête à trancher dans les urnes, au risque de donner les clés à des forces que l’Élysée voulait tenir à l’écart. La France s’avance donc à reculons vers une recomposition brutale, où l’absence de budget devient le symbole d’une République qui fonctionne désormais par défaut plus que par projet.