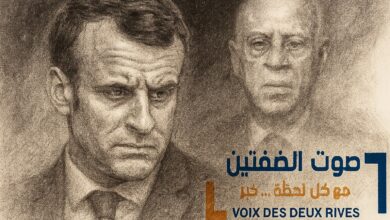NIZAR JLIDI ECRIT/Flottille Sumud : l’assaut israélien qui met le droit international à l’épreuve


En arraisonnant en haute mer la flottille humanitaire Sumud, Israël a déclenché une onde de choc juridique et diplomatique. Alors que Donald Trump tente d’imposer un plan de paix présenté comme « historique », Tel-Aviv persiste dans la confrontation, quitte à défier Washington. Entre droit international bafoué, réalignements stratégiques et fractures au sein du camp occidental, Gaza s’impose une nouvelle fois comme le miroir des rapports de force mondiaux et de la sauvagerie de l’entité sioniste.
Dans la nuit du 1er au 2 octobre, une cinquantaine de navires partis d’Espagne pour acheminer vivres et médicaments vers Gaza ont été interceptés par la marine israélienne. Les images des soldats montant à bord de bateaux battant pavillons européens, maghrébins ou latino-américains, en pleine haute mer, ont aussitôt fait le tour du monde. À bord se trouvaient des élus, des journalistes, des militants connus, tous unis derrière un objectif : briser un blocus dénoncé depuis des années comme illégal. En réponse, Israël a revendiqué son droit à empêcher toute intrusion, arguant de la légitimité d’un siège imposé depuis 2007. Mais la scène a pris une dimension inattendue : au moment même où Donald Trump dévoilait un plan en vingt points pour « la paix à Gaza », étonnement et en grande partie accepté par le Hamas, Netanyahu choisissait à nouveau l’épreuve de force.
La flottille et l’illégalité du blocus
Le 2 octobre, alors que la Global Sumud Flotilla approchait des côtes de Gaza, l’armée israélienne a intercepté ses navires un à un. Plus de quarante bateaux avaient quitté l’Espagne fin août, arborant chacun le drapeau palestinien. À bord, plus de 450 militants, élus et personnalités publiques venus de tous horizons – de Greta Thunberg à l’eurodéputée française Rima Hassan, en passant par l’ancien maire de Barcelone Ada Colau. Leur objectif : forcer le passage du blocus maritime pour livrer une aide humanitaire dans une enclave à bout de souffle après près de deux ans de bombardements ininterrompus.
Or, la question de la légalité de ces interceptions ne souffre guère d’ambiguïté. Les navires ont été arraisonnés bien au-delà des 12 milles de mer territoriale, parfois à plus de quarante milles des côtes, dans la zone économique exclusive égyptienne. Selon la convention de Montego Bay (1982), seul l’État du pavillon a juridiction en haute mer. Israël n’avait donc aucun droit d’imposer ses forces dans ces eaux. « Les ZEE ne sont pas des zones de souveraineté », rappelle Nathalie Ros, spécialiste du droit international maritime.
Israël invoque l’exception du « blocus », présenté comme légal dans le cadre du droit des conflits armés. Mais ce raisonnement se heurte à deux obstacles majeurs. D’une part, la Cour internationale de justice a rappelé dès janvier 2024 qu’aucun État ne pouvait entraver l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza. D’autre part, le Manuel de San Remo de 1994 interdit explicitement tout blocus visant à affamer une population civile ou causant des dommages disproportionnés à son accès aux biens essentiels. Or, les bateaux transportaient vivres et matériel médical, comme en attestent les images diffusées par les organisateurs.
En réalité, l’arraisonnement des navires n’est pas seulement un crime de guerre en mer, il est aussi un message politique. En arrêtant des personnalités internationales, dont plus de vingt journalistes étrangers, Israël a choisi d’assumer un bras de fer médiatique et diplomatique. Reporters sans frontières a dénoncé une violation flagrante du droit d’informer. Dans plusieurs capitales, de Barcelone à Buenos Aires, des dizaines de milliers de manifestants ont exigé la libération des militants, désormais détenus et en cours de déportation.
Trump, Netanyahu et l’ombre d’un faux cessez-le-feu
Au moment même où la Global Sumud Flotilla était stoppée en haute mer, un autre front se jouait dans les coulisses diplomatiques. Le président américain Donald Trump a dévoilé un plan en vingt points censé mettre fin à la guerre de Gaza. Ce texte, accepté officiellement par Benjamin Netanyahu et accueilli favorablement par le Hamas, promettait un cessez-le-feu rapide, le retour de tous les otages, ainsi qu’une reconstruction placée sous l’égide d’un « Board of Peace » présidé par Trump lui-même. L’idée : transformer Gaza en une zone « déradicalisée », reconstruite grâce à des financements internationaux, sous un contrôle technocratique palestinien supervisé par un organe international.
Le discours semblait, sur le papier, calibré pour séduire l’opinion internationale : libération simultanée de prisonniers, promesses d’aide massive, réintégration progressive des institutions palestiniennes et même, à terme, un « horizon » vers l’autodétermination. Mais derrière cette façade, plusieurs éléments posent problème. Le projet érige Trump non seulement en médiateur, mais en chef d’orchestre institutionnel, s’arrogeant un rôle inédit dans l’administration d’un territoire occupé. La mention explicite d’anciens dirigeants occidentaux, comme le boucher de l’Iraq Tony Blair, renforce l’idée d’un protectorat déguisé, sous couvert d’une paix « durable ».
Hamas, dans un communiqué relayé par Trump lui-même sur ses réseaux, s’est dit prêt à accepter le principe d’un échange généralisé de prisonniers et une amnistie pour ses membres qui déposeraient les armes. Mais cette ouverture s’accompagne de conditions : retrait total de l’armée israélienne, rejet de toute réinstallation forcée de Palestiniens hors de Gaza, et reconnaissance d’un rôle palestinien autonome dans la gestion de l’après-guerre. Autrement dit, Hamas accepte le dialogue mais refuse une capitulation maquillée.
La fragilité du plan s’est immédiatement révélée. Dès le 4 octobre, alors que Trump exhortait Israël à « arrêter les bombardements » pour permettre la libération des otages « en toute sécurité », Tsahal reprenait ses frappes sur la bande de Gaza, faisant plus de trente morts en quelques heures. Ce décalage illustre la duplicité d’un Netanyahu qui, en acceptant publiquement le plan, cherche surtout à gagner du temps et à garder la main sur l’agenda militaire. Pour lui, céder le contrôle sécuritaire de Gaza à une force internationale serait reconnaître l’échec de son gouvernement et briser le récit d’Israël comme « seul garant de sa propre sécurité ».
Ainsi, alors que Trump tente de se poser en artisan de la paix et que Hamas manifeste un pragmatisme inédit, Israël continue de pratiquer une politique du fait accompli. Le plan apparaît moins comme une opportunité de paix que comme un nouvel écran de fumée, révélant les contradictions d’un Premier ministre israélien plus préoccupé par sa survie politique interne que par la recherche d’une issue véritable au conglomérat de crimes de guerres qui lui incombent.
La réaction internationale et le poids du droit
L’interception de la Global Sumud Flotilla a déclenché une onde de choc planétaire. Des milliers de cortèges se sont formés à Barcelone, Buenos Aires, Tunis ou Sydney, rassemblant des dizaines de milliers de personnes pour dénoncer la saisie des navires humanitaires et l’arrestation de près de 500 passagers venus de tous les continents. En Belgique, plusieurs milliers de manifestants se sont retrouvés devant le Parlement européen, tandis qu’en Italie, les syndicats ont appelé à une grève générale pour exiger l’arrêt immédiat de la « machine génocidaire israélienne ».
La présence à bord de personnalités connues a amplifié l’écho médiatique. Greta Thunberg, l’ancienne maire de Barcelone Ada Colau ou encore l’eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan faisaient partie des arrêtés. Le direct brutalement interrompu de cette dernière, avant qu’elle ne jette son téléphone à la mer, a marqué les esprits. Les autorités israéliennes n’ont pas seulement visé des militants : une vingtaine de journalistes ont aussi été placés en détention, ce que Reporters sans frontières a qualifié de « violation grave de la liberté de la presse ». Une déclaration qui marque cependant une dissonance avec les faits : depuis 2 ans, plus de 220 journalistes ont été délibérément tués par l’armée israélienne à Gaza. C’est dire : Netanyahu ne s’intéresse pas réellement à la liberté de la presse, encore moins à la vie des civils.
Les chancelleries ont vite réagi. La Colombie a expulsé les diplomates israéliens et suspendu son accord de libre-échange avec Tel-Aviv. En Europe, plusieurs gouvernements – France, Allemagne, Irlande, Espagne, Grèce – ont exigé le respect des droits des détenus et rappelé qu’un blocus, même présenté comme légal, n’autorise pas l’arraisonnement en haute mer de navires battant pavillon étranger. La rapporteure spéciale de l’ONU pour la Palestine, Francesca Albanese, a dénoncé un « enlèvement illégal », tandis que des juristes rappelaient que la convention de Montego Bay de 1982 réserve la juridiction aux États du pavillon. Les navires se trouvaient, pour la plupart, dans la zone économique exclusive égyptienne, où Israël n’a aucune compétence.
En théorie, le droit international ne souffre pas d’ambiguïté : seule la piraterie ou la traite d’êtres humains peuvent expliquer une interception en haute mer. Israël s’appuie sur le Manuel de San Remo de 1994 pour défendre son blocus, mais ce texte impose que l’avantage militaire tiré d’un blocus soit proportionné aux dommages causés aux civils. Or, depuis 2007, le siège imposé à Gaza est largement dénoncé comme une punition collective interdite par le droit des conflits armés. La Cour internationale de justice, en janvier 2024, avait déjà rappelé qu’aucun Etat ne peut entraver l’acheminement d’une aide humanitaire vitale.
Cette discordance entre la lettre du droit et la pratique israélienne explique l’ampleur des mobilisations, dans des pays où les citoyens découvrent à peine la réalité du génocide israélien à Gaza. Pour beaucoup d’élus, de syndicalistes et de figures de la société civile qui ont soutenu la flottille, l’enjeu ne se limitait pas à acheminer vivres et médicaments. Il s’agissait de confronter Israël à une question de légitimité : celle d’un blocus que même l’ONU refuse de qualifier de conforme au droit.

Le sort des militants arrêtés et les calculs de Tel-Aviv
À peine interceptée, la flottille a été méthodiquement neutralisée : 461 passagers arrêtés, puis pour certains redirigés vers leurs pays d’origine. Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé ce samedi l’expulsion de 137 militants vers la Turquie, annonçant que le reste suivrait rapidement. Les responsables israéliens assurent que tous sont « en bonne santé », tout en cherchant à solder au plus vite une affaire devenue embarrassante.
Cette précipitation n’est pas anodine. L’entité sioniste sait qu’elle a franchi une ligne rouge en intervenant de nouveau illégalement dans des eaux où sa souveraineté n’existe pas. Face aux protestations mondiales, la stratégie consiste à réduire la visibilité des détentions en accélérant les expulsions. Pourtant, plusieurs dizaines d’activistes, dont des parlementaires et des figures médiatiques, ont entamé une grève de la faim, refusant d’être traités comme de simples fauteurs de troubles.
Le sort des journalistes arrêtés cristallise une indignation particulière. Leur détention apparaît comme une tentative d’effacer les traces visuelles d’une opération controversée par Tsahal. En contrôlant l’image et en coupant les canaux de communication des passagers, Tel-Aviv cherche à imposer son récit : celui d’une action défensive visant à empêcher une « violation de blocus ». Mais la brutalité des méthodes employées risque de produire l’effet inverse, en donnant du crédit à ceux qui accusent Israël de transformer la mer Méditerranée en champ de bataille illégal.
Cette séquence s’inscrit dans une tactique éprouvée : répondre par la force, puis noyer le scandale dans des procédures administratives rapides. Mais elle révèle aussi un paradoxe : plus Netanyahu tente de montrer qu’il maîtrise la situation, plus son isolement diplomatique s’accentue, à mesure que des capitales occidentales traditionnellement soumises s’alignent sur le langage de la violation du droit.
Les implications pour le plan Trump et la relation Netanyahu-Trump
L’affaire de la flottille éclate au moment où Donald Trump tente d’imposer son « plan de paix » en vingt points. Ce texte, accepté par Netanyahu sur le papier, devait marquer la fin d’un cycle de guerre à Gaza. Il prévoyait le retrait progressif de l’armée israélienne, la libération des prisonniers palestiniens et l’instauration d’une gouvernance provisoire placée sous l’œil d’un « Board of Peace ». Mais dès la signature, le doute s’est imposé : Israël avait-il réellement l’intention de s’y conformer ?
Les bombardements de ce 4 octobre, qui ont causé plus de trente morts, montrent à quel point Netanyahu poursuit sa logique de confrontation, quitte à défier son principal allié. La capture des navires humanitaires accentue encore cette impression de duplicité. Comment parler de « redéveloppement » ou de « zone pacifiée » quand les convois d’aide sont saisis en pleine mer et leurs passagers traités comme des criminels ?
Dans cette affaire, Netanyahu semble jouer une partie dangereuse : bénéficier du parapluie diplomatique américain tout en affichant une liberté d’action totale. Trump, en quête d’un succès symbolique, n’a pas intérêt à voir son initiative torpillée, mais il peine à imposer sa volonté à un présumé partenaire qui n’entend pas céder le moindre avantage stratégique.
Le risque pour Washington est double : perdre la main sur le dossier en laissant Netanyahu fixer seul les règles, et donner à l’opinion internationale l’image d’un plan de paix vidé de sens dès sa première épreuve. La flottille Sumud, en forçant Israël à se dévoiler dans toute sa rigidité, agit comme un révélateur de cette contradiction.
La flottille Sumud aura été bien plus qu’une démonstration humanitaire : elle a mis en lumière les lignes de fracture qui traversent aujourd’hui le Moyen-Orient et au-delà. En interceptant des navires en eaux internationales, Israël a rappelé qu’il ne reconnaissait aucune limite, ni aux critiques venues d’Europe ou des instances onusiennes. Mais ce geste brutal a aussi révélé une fragilité politique : l’incapacité de Netanyahu à traduire en actes l’accord accepté avec Donald Trump.
Le plan américain promettait un horizon de reconstruction et de stabilité, mais les bombardements de Gaza et la brutalité contre les activistes démontrent que la paix annoncée reste une paix théorique. Le paradoxe est là : Trump voulait se poser en artisan de la sortie de crise, Netanyahu en partenaire obligé, et la scène internationale découvre que l’un et l’autre avancent en réalité sur des chemins divergents.
Dans ce contexte, la flottille agit comme un symbole. Elle aura fédéré des élus, des militants, des personnalités publiques venus de tous horizons, rappelant que la cause palestinienne conserve une puissance de mobilisation intacte. Israël peut réprimer, expulser et défier les règles du droit maritime, mais il ne peut empêcher que l’opinion mondiale s’empare de cette histoire comme d’une nouvelle preuve de l’isolement grandissant de Tel-Aviv.
La question reste ouverte : Trump pourra-t-il imposer son plan face à un « allié » qui choisit la confrontation, ou verra-t-il sa promesse de paix réduite à un slogan sans lendemain ? La réponse se jouera autant dans les capitales occidentales que dans les rues qui, de Barcelone à Buenos Aires, scandent déjà le refus du statu quo.