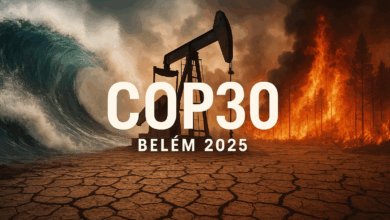Nizar Jlidi écrit / Népal : de la rue en feu au laboratoire géopolitique


En dix jours, Katmandou est passée du chaos à une fragile accalmie. La nomination surprise de Sushila Karki, ex-présidente de la Cour suprême, a offert au pays un répit après un soulèvement meurtrier mené par la jeunesse. Mais derrière cette « parenthèse Karki », c’est l’avenir d’un État charnière qui se joue : petit par la taille, le Népal concentre désormais les regards de la Chine, de l’Inde et des Etats-Unis.
Le 12 septembre, la photo a fait le tour de Katmandou : Sushila Karki, 73 ans, main levée face au président Ram Chandra Paudel, prête serment comme Première ministre intérimaire. Première femme à occuper ce poste, première juge connue pour son intransigeance anticorruption, et première dirigeante à surgir d’un compromis inédit entre armée, jeunesse et institutions. La scène tranchait avec celles des jours précédents : rues en flammes, 74 morts, plus de deux mille blessés, bâtiments gouvernementaux incendiés, symbole d’un pays à bout de souffle.
Les manifestations n’étaient pas seulement la conséquence d’un projet d’interdiction des réseaux sociaux, comme l’ont écrit certains médias. Elles étaient l’aboutissement d’années de corruption, de népotisme et de promesses trahies. Ledit« mouvement Génération Z », nourri d’une jeunesse instruite mais sans perspectives, a fait basculer l’ordre établi. Dans l’instant, les élites ont vacillé : Khadga Prasad Sharma Oli a quitté le pouvoir, et les trois grands partis qui dominaient depuis deux décennies ont perdu la main.
Du chaos à l’accalmie : la « parenthèse Karki »
Dans un pays marqué par une décennie de guerre maoïste puis par la constitution contestée de 2015, les émeutes de septembre 2025 ont eu un parfum de déjà-vu. Mais leur intensité a surpris : plus de soixante-dix morts en deux jours, des affrontements devant SinghaDurbar, siège du gouvernement, et des domiciles de ministres incendiés. La colère ciblait autant les figures politiques vieillissantes que leurs héritiers — ces « nepo babies » qui étalent leur richesse sur les réseaux.
L’armée est intervenue, non pas pour écraser la rue, mais pour encadrer une transition. Le choix de Sushila Karki a été présenté comme celui d’une personnalité « au-dessus de la mêlée ». Elle a promis un panel d’enquête sur les violences, présidé par Gauri Bahadur Karki, ancien magistrat anticorruption, avec mandat de trois mois. Elle a aussi annoncé la création d’un comité anticorruption et s’est engagée à préparer des élections législatives en mars 2026. « Nous devons corriger les défaillances qui ont conduit à ces protestations meurtrières : transparence, emplois, niveau de vie », a-t-elle martelé dès son arrivée.
Mais le calme reste conditionnel. « Le nouveau gouvernement peut tomber aussi s’il n’agit pas », a averti Sudan Gurung, l’une des figures de la mobilisation étudiante. Dans les quartiers populaires de Katmandou comme dans les plaines madhésies, les attentes sont immenses : voir enfin sanctionnés les barons politiques accusés de s’être enrichis pendant que les familles survivaient grâce aux envois de fonds des travailleurs expatriés. La « parenthèse Karki » est donc à la fois un apaisement et une épée de Damoclès : elle suspend la colère, sans la dissiper… et elle donne le temps aux puissances mondiales d’infiltrer la transition népalaise.
Un pays simple, une importance démesurée
À première vue, le Népal pourrait sembler marginal : 30 millions d’habitants, un PIB inférieur à celui de beaucoup de métropoles indiennes, et une économie encore largement adossée aux envois de fonds des travailleurs migrants. Mais dans la géopolitique contemporaine, sa situation fait toute la différence. Enclavé entre les deux géants asiatiques, il n’a pas le luxe de l’isolement. Et à mesure que les tensions régionales s’exacerbent, chaque kilomètre carré de son territoire devient un enjeu de souveraineté.
Le premier levier est énergétique. Le Népal a un potentiel hydroélectrique colossal, dont une infime partie seulement est exploitée. Cet été, Katmandou a exporté pour la première fois 40 mégawatts d’électricité vers le Bangladesh, en transitant par le réseau indien. Ajoutés aux 80 MW déjà livrés au Bihar, en Inde, ces chiffres paraissent modestes mais ils sont révélateurs : c’est l’Inde qui tient la clé de voûte logistique. Toute exportation régionale dépend de ses infrastructures et de son bon vouloir. Cela donne à New Delhi un moyen de pression constant, un rappel que l’économie népalaise reste enchaînée aux choix de son voisin.
À l’inverse, Pékin tente de briser cette dépendance en proposant des lignes transhimalayennes. La signature, en juillet, d’un accord de faisabilité pour la ligne Rasuwagadhi–Kerung doit permettre de connecter directement Katmandou au réseau chinois. Mais ce projet reste fragile : la frontière nord est régulièrement perturbée par des glissements de terrain, comme l’a rappelé la crue de juillet qui a emporté une partie des installations et coupé l’axe pendant des semaines. Les routes vers la Chine existent sur le papier, mais leur viabilité reste aléatoire. Problème : ça fait également du Népal un potentiel de menace militaire contre l’Empire du Milieu, si Katmandou devait s’aligner sur les Etats-Unis, par exemple.
Enfin, Washington, moins visible mais tout aussi présent, avance ses pions à travers le Millennium Challenge Corporation. Ce compact de 500 millions de dollars, signé en 2017 et ratifié après des années de débats houleux, finance des lignes de transport électrique et des réhabilitations routières. Officiellement, il s’agit d’un programme de développement. Mais dans les faits, il inscrit le Népal dans l’architecture indo-pacifique voulue par les Etats-Unis, un maillage où l’aide économique sert aussi d’outil stratégique de pression.
Au-delà de ces infrastructures, le Népal vit de ses migrants. Chaque année, les travailleurs népalais installés au Qatar, en Malaisie ou en Corée du Sud renvoient des milliards de dollars à leurs familles. Ces remises représentent plus d’un quart du PIB. C’est ce qui maintient un équilibre précaire : l’agriculture décline, l’industrie reste embryonnaire, et la jeunesse instruite s’accroche à l’espoir d’un départ. Cette dépendance externe fragilise le pays mais en fait aussi un terrain d’expérimentation : toute coupure d’accès, qu’elle soit indienne, chinoise ou américaine, a un effet immédiat sur la stabilité intérieure.
Ce paradoxe est central : le Népal est un petit Etat, mais il concentre en miniature les dynamiques politiques globales. Son hydroélectricité attire les appétits de ses voisins, ses routes deviennent des corridors stratégiques, ses finances sont irriguées par des programmes occidentaux, et sa jeunesse incarne l’impatience d’un Sud global connecté mais frustré. Un pays simple, oui, mais qui devient, par la force des choses, une pièce disproportionnée sur l’échiquier mondial.
Chine, Inde, États-Unis : l’échiquier himalayen
Chaque projet, chaque route, chaque mégawatt d’électricité qui transite par Katmandou est scruté à Pékin, à New Delhi et à Washington. Le Népal est devenu le miroir miniature de la compétition mondiale.
Pour la Chine, l’enjeu est d’ouvrir une fenêtre au sud du Tibet. Pékin pousse depuis des années pour transformer Katmandou en point d’appui de ses « Nouvelles routes de la soie » (BRI). Le projet de ligne Rasuwagadhi–Kerung, financé par la CIDCA, s’inscrit dans cette logique : amener l’électricité népalaise vers la Chine et, à terme, intégrer le pays à la BRI. Mais Pékin doit manier le dossier avec subtilité : toute avancée trop visible provoque l’hostilité de L’Inde (avec laquelle les hostilités viennent à peine de s’adoucir). La Chine sait que la stabilité du Népal est fragile, et que la rue peut se retourner contre tout projet perçu comme une ingérence.
Pour l’Inde, le Népal reste d’abord une zone tampon vitale. New Delhi n’a pas digéré la carte publiée en 2020 par Katmandou incluant les territoires de Kalapani, Lipulekh et Limpiyadhura. Quand, en août dernier, l’Inde a rouvert officiellement le col de Lipulekh avec la Chine, sans inclure le Népal dans l’accord, le Parlement de Katmandou a protesté, dénonçant une négociation « par-dessus sa tête ». L’Inde avance ses pions avec pragmatisme : elle verrouille les exportations électriques du Népal et rappelle à intervalles réguliers que la sécurité de sa frontière himalayenne n’est pas négociable. Pour les stratèges indiens, un Népal trop proche de Pékin serait une menace directe pour leur flanc nord.
Les Américains, de leur côté, jouent une partition moins spectaculaire mais tout aussi stratégique. Le MCC est leur instrument principal : un paquet d’infrastructures qui inscrit le Népal dans l’orbite américaine. Le Département d’État insiste sur la prospérité et la « sécurité régionale », mais la lecture indo-pacifique est évidente : dans l’esprit de Washington, Katmandou doit rester hors de la sphère chinoise. Certains jeunes leaders népalais accusent déjà les ONG américaines (la CIA, pour les plus virulents) d’avoir infiltré ou encouragé les manifestations contre Oli, comme au Bangladesh ou au Pakistan. Rien n’est prouvé, mais la méfiance grandit.
Ainsi se dessine un triangle de contrainte proverbial : Pékin propose des alternatives de connectivité, New Delhi contrôle le présent économique par ses réseaux et ses routes, Washington offre des financements conditionnés. Pour Katmandou, chaque signature d’accord est un pari risqué. Pour la jeunesse népalaise, c’est une évidence : leur pays n’est plus seulement le théâtre d’une lutte contre la corruption, mais un échiquier où les grandes puissances déplacent leurs pièces à bas coût.
Le laboratoire global : pourquoi le Népalest important
À première vue, le Népal pourrait sembler un théâtre périphérique, trop montagneux et trop pauvre pour compter. Mais c’est justement sa marginalité apparente qui en fait un laboratoire de la confrontation mondiale. Quand les Etats-Unis, la Chine ou l’Inde testent leurs stratégies d’influence, ils le font dans des environnements où le coût politique est limité. Le Népal offre ce terrain d’expérimentation idéal.
Pour l’Europe, l’enjeu est double. D’abord, l’électricité verte : les Himalayas recèlent un potentiel hydroélectrique énorme. Si Pékin capte cette ressource pour la connecter au Tibet, elle renforcera son poids énergétique et technologique dans toute l’Asie. Si New Delhi la verrouille, c’est l’Inde qui consolidera son statut de puissance régionale incontournable. Dans les deux cas, l’Europe se retrouve marginalisée, simple spectatrice d’un marché énergétique qui aurait pu être diversifié et partiellement tourné vers elle.
Ensuite, la dynamique politique. La révolte de la jeunesse népalaise contre la corruption et le clientélisme fait écho aux mouvements qui secouent d’autres pays du Sud global. Dans un monde où la polarisation ne se limite plus à « Ouest contre Est » mais oppose aussi des sociétés civiles à des élites verrouillées, le Népal rappelle que la jeunesse est devenue un acteur géopolitique en soi.
Pour l’Afrique du Nord, la comparaison est plus directe encore. Les économies reposant sur les transferts de fonds, l’endettement massif et la dépendance alimentaire connaissent les mêmes fragilités. Quand Katmandou bascule, c’est un avertissement pour Tunis, Rabat ou Le Caire : les soulèvements ne sont plus seulement idéologiques, ils sont sociaux et générationnels.
Enfin, le message global est limpide : il n’y a plus de « petits pays ». Un État de 30 millions d’habitants, niché entre deux géants, devient une pièce de l’échiquier planétaire. Dans cette ère de compétition multipolaire, chaque crise locale résonne comme une répétition générale des affrontements de demain. Le Népal est aujourd’hui un miroir, grossissant les fractures d’un ordre mondial en recomposition.
Le soulèvement népalais et l’arrivée de Sushila Karki au pouvoir ne sont pas qu’une affaire domestique. Ils cristallisent à la fois l’épuisement d’un système politique verrouillé et la pression croissante des grandes puissances sur un Etat charnière. Dans l’ombre de l’Himalaya, les dirigeants Américains, Chinois et Indiens observent chaque pas de Katmandou, conscients que ce petit pays peut influer sur des équilibres plus vastes : routes commerciales, sécurité régionale, contrôle énergétique.
Mais au-delà de la géopolitique, le Népal met en lumière une constante du temps présent : l’ambition d’une jeunesse éduquée, connectée, mais privée d’horizons. Là où les institutions s’enlisent, elle invente ses propres outils de mobilisation, quitte à bousculer violemment les élites. Cette colère générationnelle, qu’on retrouve au Sud de l’Asie, en Afrique de l’Ouest, au Maghreb ou en Europe de l’Est, donne au cas népalais une portée universelle.
En somme, si Katmandou semble lointaine, ses secousses disent quelque chose d’essentiel sur notre époque : la fragilité des ordres établis et la vitesse avec laquelle une crise locale peut devenir un signal global.