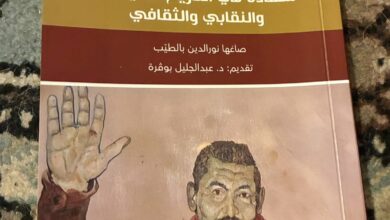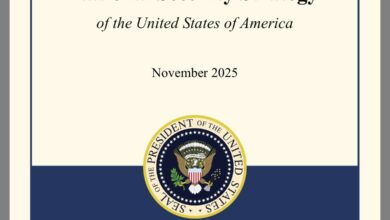Qatar bombardé, Israël acculé : entre le sommet de Doha et la flottille Sumud
Par l'écrivain et l'analyste politique NIZAR JLIDI

L’attaque israélienne du 9 septembre a tué six personnes à Doha, sans atteindre sa cible – la délégation du Hamas. Elle a violé la souveraineté d’un allié des Etats-Unis, creusé un fossé entre Washington et Tel-Aviv et déclenché un sommet arabo-islamique inédit, ouvert ce lundi 15 septembre. Le Qatar, loin d’être affaibli, transforme l’agression sioniste en levier diplomatique.
L’après-midi du 9 septembre restera comme une première : un missile israélien s’est abattu en plein Doha, à quelques kilomètres de la base américaine d’Al-Udeid. Six personnes sont mortes, dont Hammam al-Hayya, fils du chef de la délégation du Hamas, et un officier de sécurité qatari. Les dirigeants visés, eux, ont survécu. Cette frappe n’a donc pas seulement manqué son objectif : elle a révélé la méthode du fait accompli israélien et placé les États-Unis dans une position intenable. La Maison Blanche a reconnu avoir prévenu Doha « trop tard ». Donald Trump a exprimé son « grand mécontentement », dénonçant une attaque qui « met en danger un allié essentiel et médiateur incontournable ».
Le Premier ministre et chef de la diplomatie du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, a parlé de « terrorisme d’État » et de « coup porté à la médiation ». Ses mots ont trouvé un écho rare au Conseil de sécurité des Nations unies : le 11 septembre, les quinze membres, y compris Washington, ont signé un communiqué condamnant l’attaque. Un consensus inhabituel dès lors qu’Israël est en cause, qui mesure la gravité du précédent.
Dès le lendemain, Doha a convoqué un sommet d’urgence réunissant la Ligue arabe et l’Organisation de la coopération islamique. Ce format conjoint, encore jamais vu pour un sujet de cette nature, s’est ouvert le 15 septembre. Dans les couloirs, on évoque un projet de résolution avertissant que ces frappes mettent « en péril tout processus de paix ». La date, symbolique, coïncide avec le cinquième anniversaire des Accords d’Abraham. Israël voulait imposer sa loi ; le Qatar a transformé l’agression en tribune.
La présence annoncée du président iranien Massoud Pezeshkian et du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif donne au sommet une densité particulière. Elle signale que l’affaire dépasse la solidarité rituelle : il s’agit désormais de fixer une ligne rouge. Dans la salle, chacun le sait — si frapper Gaza est malheureusement toléré par les chancelleries occidentales, frapper Doha, allié de Washington et carrefour diplomatique, relève d’une transgression d’un autre ordre.
Les leviers silencieux de l’émirat
Doha n’a pas d’armée démesurée ni de territoire étendu. Sa puissance repose ailleurs : sur des leviers discrets mais redoutablement efficaces, qui transforment chaque crise en opportunité. L’attaque israélienne du 9 septembre l’a montré : frapper un médiateur, c’est toucher un nœud de dépendances que beaucoup préfèrent ménager.
Premier levier, le militaire. À Al-Udeid, au sud-ouest de Doha, s’étend la plus grande base américaine hors des États-Unis. Le Central Command (CENTCOM) y a installé son quartier général avancé. Plus de 10 000 militaires américains y stationnent, avec la logistique qui permet de contrôler à la fois le Golfe, l’Iran et l’Afghanistan. Pour Washington, c’est une pièce maîtresse de son dispositif stratégique. En 2019, le Qatar a injecté plus de 1,8 milliard de dollars dans l’extension de la base, signe d’une interdépendance assumée avec les Etats-Unis. À quelques kilomètres, une base turco-qatarie abrite plus de 3 000 soldats, symbole du partenariat avec Ankara. Frapper Doha, c’est donc mettre sous tension deux armées de l’OTAN et compliquer les calculs régionaux.
Deuxième levier, l’énergie. Le Qatar est le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. Son champ géant du North Field, partagé avec l’Iran, est en cours d’extension. L’objectif est d’atteindre 142 millions de tonnes par an d’ici 2030, contre 77 aujourd’hui. L’Europe a déjà signé pour des contrats de vingt ans, afin de compenser la rupture avec Moscou. En décembre 2022, TotalEnergies a obtenu une part dans le projet North Field East ; l’Allemagne, l’Italie et la France dépendent de ces flux. Doha n’a pas besoin de brandir la menace de couper le robinet : le simple rappel de cette dépendance suffit à influencer les chancelleries européennes.
Troisième levier, la finance. Avec près de 560 milliards de dollars d’actifs, la Qatar Investment Authority (QIA) a pris pied dans des secteurs stratégiques : parts dans Volkswagen et Barclays, immeubles de prestige à Paris et Londres, ports et aéroports européens. Chaque réallocation, même minime, est scrutée par les marchés. Le Qatar n’a pas besoin de gestes spectaculaires : quelques signaux suffisent à rappeler que son argent irrigue des capitales qui ne peuvent se permettre de le perdre.
Enfin, le soft power. Al Jazeera, créée en 1996, reste la chaîne arabe la plus influente, et l’une des agences médiatiques les plus crédibles dans le monde. Sa couverture des guerres, des révoltes arabes et aujourd’hui de Gaza, fixe souvent l’agenda médiatique mondial. À cela s’ajoutent le PSG, vitrine sportive planétaire, et l’héritage de la Coupe du monde 2022, première jamais organisée dans le monde arabe. Cette capacité d’image permet au Qatar de transformer une attaque en récit global : le petit émirat encerclé qui impose des règles aux grandes puissances.
Ces leviers ne sont pas théoriques. Ils pèsent sur la table des négociations, rappellent que le Qatar n’est pas seulement une cible, mais un hub incontournable. C’est pourquoi la frappe du 9 septembre, loin d’affaiblir l’émirat, a renforcé son poids.
De la médiation à la règle : codifier le tabou
Au-delà de la condamnation, Doha cherche à transformer l’attaque du 9 septembre en précédent. L’idée n’est pas la revanche, mais la codification d’un tabou : on ne frappe pas un médiateur, surtout lorsqu’il abrite sur son sol la principale base américaine de la région. C’est ce message que le petit émirat met au cœur du sommet arabo-islamique ouvert le 15 septembre.
Le projet de résolution discuté dans la capitale qatarie est clair : ces frappes menacent non seulement la paix régionale mais aussi les processus de « paix à travers la normalisation » entamés depuis 2020. Le texte insiste sur la protection de la souveraineté des États hôtes et vise implicitement à établir une règle de non-agression des plateformes de médiation. Dans la salle, la présence du président iranien Massoud Pezeshkian et du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a donné une profondeur inédite au débat. Officiellement, ils sont venus manifester leur solidarité. Officieusement, leur rôle dépasse l’affichage.
Selon une source diplomatique impliquée dans la préparation du sommet, des discussions portent sur la relocalisation discrète de familles de responsables palestiniens vers l’Iran, afin d’éviter que leur présence à Doha ne serve de prétexte à de nouvelles frappes. Cette option, explorée sous médiation de Riyad et d’Islamabad, vise à sanctuariser le rôle du Qatar. Elle n’affaiblirait pas la position politique du Hamas ni les canaux de dialogue, mais elle protégerait Doha et garantirait la continuité de la médiation.
Israël, conscient du danger de cette équation, tente de détourner l’attention. La presse hébraïque a multiplié les insinuations sur une prétendue transformation de la Tunisie en « base arrière du Hamas ». Or la réalité est inverse : Tunis, avec Alger, a été impliquée aux pourparlers visant justement à éloigner de son territoire toute installation sensible. Les accusations tombent au moment où la Tunisie enquête sur les attaques contre la flottille Sumud, ciblée à deux reprises en mer par des drones. D’abord niées, ces attaques sont désormais qualifiées d’« acte prémédité » par les autorités tunisiennes. Les insinuations médiatiques israéliennes apparaissent comme une pression directe sur cette enquête.
C’est dans cette tension que le Qatar forge son nouveau rôle. Non pas simple hôte, mais architecte de normes. Son objectif : inscrire dans le droit et la pratique internationale qu’un Etat médiateur ne peut être frappé sans que l’agresseur en paie le prix politique au moins. Pour Tel-Aviv, le calcul initial devait affaiblir Doha. Il a eu l’effet inverse : le Qatar est désormais le centre d’un front qui, de Téhéran à Islamabad, de Riyad à Alger, s’accorde sur une évidence — la médiation n’est pas une cible.
La flottille Sumud, ou la frappe médiatique de trop
Alors que les dirigeants de la région MENA se réunissent à Doha, la flottille Sumud traverse la Méditerranée, direction Gaza. Elle ne bouleversera probablement pas l’équilibre militaire, mais elle peut infliger une défaite symbolique. Vingt bateaux, des militants venus de plus de quarante pays, des figures connues — l’expédition a levé l’ancre de Bizerte le 13 septembre, malgré deux attaques mystérieuses en escale tunisienne. D’abord un incendie à bord du Family, pavillon portugais, imputé par la gendarmerie tunisienne à une cause technique ; puis, la nuit suivante, une attaque plus claire contre l’Alma, pavillon britannique. Cette fois, les autorités tunisiennes ont parlé d’« acte prémédité » et ouvert une enquête. Aucun blessé, mais des images : une lumière dans le ciel, un feu qui prend, et la voix d’une rapporteuse de l’ONU, Francesca Albanese, rappelant que si un drone est impliqué, il s’agit d’une violation de souveraineté.
Depuis 2010, Israël intercepte toutes les flottilles qui approchent Gaza. Mais le poids politique n’est plus dans l’arrivée : il est dans le voyage. Deux incidents en Tunisie, puis un départ maintenu malgré tout, créent un récit puissant. Au moment où Doha accueille un sommet arabo-islamique inédit pour codifier l’interdit des frappes sur médiateurs, une flottille multinationale trace sa route vers Gaza. Les deux séquences se répondent : un petit émirat frappé qui transforme l’agression en levier diplomatique, et une poignée de bateaux qui résistent à l’intimidation.
Pour Israël, le risque est moins militaire que diplomatique, surtout vis-à-vis d’une opinion publique occidentale de plus en plus attentive au génocide en cours à Gaza. On peut neutraliser des navires ; on contrôle mal un récit qui s’écrit en direct, dans quarante langues. Entre les condamnations officielles de Doha et les images de Bizerte, c’est peut-être la frappe médiatique de trop : celle qui déplace l’opinion au-delà des communiqués et force les capitales à choisir un camp, ou à en assumer les conséquences.