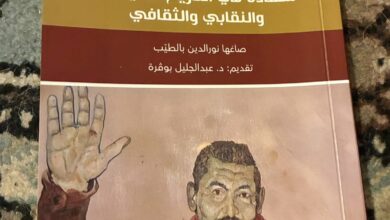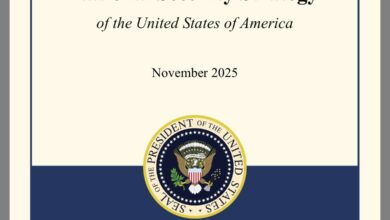La France face à la dette publique, au chômage et à la colère sociale

Depuis la crise du COVID-19, suivie de la guerre en Ukraine, la France fait face à de multiples perturbations économiques. En 2024, la croissance du PIB a atteint seulement 1,1%, selon l’Institut national des statistiques et des études économiques (INSEE), un chiffre bien en dessous des attentes pour une reprise dynamique. Plusieurs facteurs expliquent cette stagnation :
-
L’inflation reste persistante, notamment sur l’énergie et les matières premières, réduisant le pouvoir d’achat des ménages et alourdissant les coûts des entreprises.
-
Les tensions sur l’emploi se multiplient : la transformation numérique, la transition écologique et la concurrence internationale contraignent les entreprises à revoir leurs modèles économiques, entraînant des vagues de licenciements.
-
La confiance est affaiblie : l’endettement public élevé et les incertitudes sur l’avenir limitent les marges de manœuvre de l’État et des entreprises.
Une crise sociale alimentée par la fragilité économique
De nombreux secteurs connaissent des restructurations importantes. Dans l’industrie automobile, l’accélération vers les véhicules électriques pousse les sous-traitants traditionnels à adapter leurs chaînes de production, menaçant des milliers d’emplois.
Dans la distribution et le commerce, la montée de l’e-commerce et la baisse de consommation conduisent à des réductions d’effectifs et à des fermetures de magasins. Même le secteur technologique, pourtant dynamique, procède à des ajustements en raison d’une rentabilité en recul dans un contexte de surinvestissement post-COVID. Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) est devenu un outil central de ces restructurations. Depuis début 2024, près de 250 PSE ont été recensés en France, menaçant environ 150 000 emplois.
La croissance du PIB pourrait se situer entre 0,7 et 1%. L’inflation, bien que ralentie, reste élevée pour les produits alimentaires et l’immobilier, comprimant le pouvoir d’achat. Les ajustements dans l’industrie et le tertiaire pourraient faire remonter le chômage, actuellement à 7,4%. La dette publique, dépassant 112% du PIB, limite la capacité de l’État à soutenir efficacement l’activité économique.
Une crise politique et financière inédite
La France cumule quatre déficits simultanés (budget, balance commerciale, budget primaire, balance des paiements) et une dette élevée, dépassant 110% du PIB. La confiance des marchés financiers est fragile et les décisions budgétaires récentes visent avant tout à rassurer les créanciers.
La politique économique, longtemps souveraine, se trouve désormais influencée par les marchés et les investisseurs étrangers. La dette française, dépassant 3 300 milliards d’euros, entraîne une hausse des taux d’intérêt, avec un coût annuel des intérêts déjà supérieur à 60 milliards d’euros et pouvant atteindre 110 milliards d’ici 2029.
Le retour du chômage
Après avoir atteint un plus bas historique à 7,1%, le chômage remonte à 7,4 % au troisième trimestre 2024. Les annonces récentes de plans sociaux, comme chez Auchan ou Michelin, remettent le chômage au centre du débat. Selon les prévisions, il pourrait atteindre 8% d’ici fin 2025, dans un contexte de faible croissance et d’entreprises fragilisées par la fin progressive des aides publiques et la concurrence internationale.
L’érosion de la confiance et le ressentiment
La combinaison d’une dette publique élevée, d’une politique économique perçue comme distante et de la hausse du chômage alimente un sentiment de frustration et de colère. Les Français constatent que l’État dispose de marges de manœuvre limitées pour protéger les citoyens ou créer des emplois.
L’augmentation de l’épargne, au détriment de la consommation, traduit la méfiance des ménages face à l’avenir. Les réformes gouvernementales, notamment celle des retraites, ont suscité une forte contestation et renforcé le sentiment d’éloignement des citoyens vis-à-vis de l’exécutif.
Les divisions sociales se creusent
Les tensions entre différentes catégories de la population — salariés, étudiants, retraités — s’accentuent, alimentant un climat d’incertitude et des conflits sociaux. Dans ce contexte, les manifestations se multiplient. Depuis plusieurs mois, les rues françaises voient défiler des mobilisations massives, souvent accompagnées de blocages économiques et de perturbations des transports, témoignant d’une colère sociale profondément enracinée.
Le mouvement « Bloquons Tout » : une contestation politique
Le 10 septembre 2025, des dizaines de milliers de manifestants ont participé au mouvement « Bloquons Tout ». Né sur Internet, ce mouvement dénonce l’austérité budgétaire et cible directement Emmanuel Macron, considéré par beaucoup comme le symbole du système. Soutenu par certaines fédérations syndicales et La France insoumise, il illustre une colère sociale profonde et durable. Une nouvelle mobilisation nationale est prévue le 18 septembre, avec l’ensemble des syndicats appelés à participer.
Une démocratie en question
Depuis 2017, Emmanuel Macron incarne une « République du centre », rompant avec le système bipartite classique. Sa victoire a reflété la capacité de rassembler un consensus libéral, social et européen. Mais cette centralisation du pouvoir et la simplification des clivages politiques ont également révélé la fragilité du système démocratique. L’échec à créer des majorités stables, la défiance envers les institutions et la montée des mouvements radicaux montrent que la France partage avec d’autres démocraties occidentales des tensions structurelles.
Un moment critique pour la France
La France traverse une période d’incertitude inédite, marquée par des crises économiques, sociales et politiques imbriquées. La dette élevée, le chômage croissant, la montée de la contestation sociale et la fragilité démocratique imposent des choix cruciaux pour les années à venir. Les décisions prises dans les prochains mois auront des conséquences majeures sur la cohésion sociale, la stabilité économique et la légitimité politique du pays.