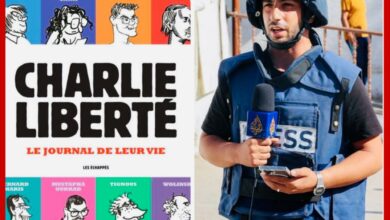La progression discrète des Frères musulmans en France : un défi sécuritaire grandissant
Par:Nizar.jlidi

En France comme dans plusieurs capitales européennes, les autorités observent avec attention les activités d’un réseau islamiste dont l’idéologie, importée du Moyen-Orient, trouve aujourd’hui des relais bien implantés sur le territoire. Classé organisation extrémiste par plusieurs États, le mouvement des Frères musulmans poursuit une stratégie d’influence à long terme, mêlant présence associative, action religieuse et implantation sociale.
Une alerte relayée au sommet de l’État
Ces derniers mois, plusieurs rapports confidentiels puis publics ont mis en lumière l’ampleur des ramifications françaises de la confrérie. Le 8 juillet, à l’issue d’un Conseil de défense et de sécurité nationale présidé par Emmanuel Macron, le gouvernement a annoncé un plan offensif pour contenir cette expansion.
Au cœur de ce dispositif : couper les canaux de financement des structures proches du mouvement, dissoudre celles identifiées comme relais de propagande, et former un corps d’imams strictement alignés sur les principes républicains. Un volet spécifique prévoit également un contrôle renforcé des discours et supports médiatiques diffusés dans ces cercles, afin de détecter tout message favorisant la radicalisation.
Des structures locales aux ramifications transnationales
Un rapport rédigé en mai dernier par un diplomate et un haut fonctionnaire de la police nationale, mandatés conjointement par les ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères et des Armées, détaille le mode opératoire du mouvement.
L’étude décrit un maillage dense d’associations caritatives, éducatives ou culturelles servant de points d’appui à une idéologie islamiste politique.
Les données officielles recensent environ 139 lieux de culte directement sous influence du mouvement, ainsi qu’une soixantaine d’autres espaces répartis sur plus de cinquante départements soit environ 7 % des mosquées en France.
Si ces chiffres restent minoritaires, la progression sur la dernière décennie est jugée significative, notamment dans les constructions postérieures à 2010.
Un ancrage qui ne date pas d’hier
La présence structurée des Frères musulmans en France remonte officiellement à 1983, avec la création de l’Union des organisations islamiques de France (UOIF).
Bien avant cette date, des acteurs liés au mouvement opéraient déjà à travers diverses associations locales.
Depuis, l’influence s’est élargie, parfois sous des bannières plus discrètes, comme le Conseil français du culte musulman (CFCM).
En 2022, plusieurs figures liées à la confrérie ont été expulsées, tandis que des enquêtes administratives et judiciaires ont ciblé ses réseaux de financement.
Une idéologie aux racines anciennes
Fondée en 1928 en Égypte par Hassan al-Banna, la confrérie se voulait initialement un mouvement réformateur prônant une vision globale de l’islam. Rapidement, l’engagement religieux a pris une dimension politique et militante.
Dans les années 1940, l’organisation a mis sur pied une branche armée clandestine, impliquée dans des assassinats politiques.
L’idéologue Sayyid Qutb, dans les années 1960, a radicalisé cette vision en appelant à la constitution d’une élite militante prête à renverser les régimes en place par la force. Ses écrits ont inspiré, directement ou indirectement, plusieurs générations de groupes djihadistes, d’Al-Qaïda à l’État islamique.
Une réponse de l’État sur plusieurs fronts
Selon des données du ministère de l’Intérieur, environ 280 associations actives sur le territoire entretiendraient des liens avec la confrérie, tout en affichant une façade caritative ou culturelle.
Pour l’exécutif, la lutte contre cette influence n’est pas seulement sécuritaire mais aussi idéologique : préserver le cadre laïque tout en empêchant l’installation d’un contre-projet politique au sein même de la société.
La réunion du Conseil de défense du 22 mai dernier a permis de renforcer les moyens de surveillance et d’intervention administrative. Les mesures dévoilées en juillet s’inscrivent dans une stratégie plus large de « réarmement républicain », visant à réduire la marge de manœuvre de ce réseau jugé capable d’affaiblir les fondements mêmes de la cohésion nationale.