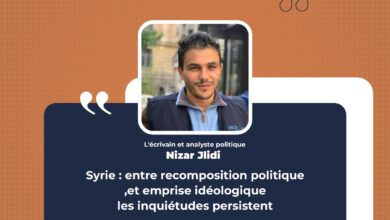L’accord commercial avec les Etats-Unis et une Europe à la croisée des chemins

L’accord commercial et énergétique préliminaire entre l’Europe et les Etats-Unis annoncé par Donald Trump et Ursula von der Leyen le 27 juillet a fait couler beaucoup d’encre. Entre peur des industriels, optimisme amer des financiers, une levée de boucliers des peuples et dirigeants européens, quel effet ce tournant aura-t-il sur l’Europe ? Analyse.
Selon l’ancien ambassadeur français aux Etats-Unis, Philippe Etienne, « L’Europe doit affronter son assimilation aux Etats-Unis au sein d’un Occident de plus en plus rejeté ».
L’image est forte : la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a essayé de se montrer digne face au président américain Donald Trump, mais la tradition servile européenne vis-à-vis des Etats-Unis peine à convaincre. D’autant plus que Trump s’est montré plus agressif que jamais, interrompant von der Leyen à répétition et insistant qu’elle le remercie publiquement d’un accord qui, objectivement, n’arrange que les intérêts américains. Concrètement, l’Union européenne (UE) s’est engagée à acheter 750 milliards de dollars de gaz liquide et de charbon américains, à investir 600 milliards dans l’économie des Etats-Unis, mais également à accepter sans réserve les exigences unilatérales de Trump sur les droits de douane.
En effet, l’accord transatlantique conclu en Ecosse dimanche dernier prévoit une taxation de 15% sur les exportations européennes vers les Etats-Unis contre des droits de douanes négligeables pour l’importation des produits américains. Une totale capitulation européenne, donc.
Si Ursula von der Leyen voit dans ce deal une issue à un conflit commercial de longue haleine, les deux puissances économiques européennes principales, la France et l’Allemagne, s’y opposent. Du coté de Berlin c’est la Fédération des industries allemandes (BDI), et surtout le chancelier Friedrich Merz – pourtant membre du parti de von der Leyen – qui voient en cet accord un « acte humiliant » et un « grand fardeau » pour l’Allemagne. Quant à la France, Emmanuel Macron a appelé à « reprendre les négociations », et son Premier ministre François Bayrou a déploré la solitude de la France face aux Etats-Unis dans ces négociations.
D’autres parties européennes gardent encore le silence. Après tout, si les Etats européens n’acceptent pas les termes de l’accord, ou plutôt s’ils s’y opposent aussi farouchement, la Commission européenne ne pourra pas le faire ratifier, et encore moins l’appliquer. Pourtant, aussi profondes les divergences entre les dirigeants européens et Trump puissent être, l’UE s’est toujours pliée aux exigences américaines. D’ailleurs, de la crise de la Covid-19, en passant par la guerre entre l’Ukraine et la Russie et jusqu’à l’alignement diplomatique sur le dossier palestinien (qui semble doucement muter), le suivisme européen s’est carrément transformé en autosabotage. Ce nouvel accord commercial entre l’Europe et les Etats-Unis serait-il donc la goutte qui fait déborder le vase ?
Les risques concrets pour l’Europe
L’année dernière, en France seulement, 66 000 entreprises ont été déclarées en défaillance selon un rapport de l’AU Group. Et cette année, dans l’ensemble de l’Union européenne, plus de 200 000 entreprises sont insolvables, dont plus de la moitié ont déjà déclaré faillite. Des chiffres records : ils représentent presque le double de l’année 2021, en pleine pandémie.
Le pire, c’est que le problème ne s’arrête pas là. Cette économie européenne exsangue subirait davantage de catastrophes si l’accord américain venait à passer. Car aux Etats-Unis, les nouveaux tarifs discréditent les exportations européennes, certes. Mais ce sont surtout les petites et moyennes entreprises (PME) et les opérateurs territoriaux européens, démunis d’un filet de protection, qui paieraient le prix fort. Des secteurs emblématiques comme les spiritueux sont directement menacés : en France, les exportations vers les Etats-Unis pourraient chuter de 20% soit environ 800 millions d’euros, certains secteurs anticipent même des taxes à hauteur de 200%. Un ralentissement industriel particulièrement marqué touche l’automobile en Allemagne, les pharmaceutiques et l’aéronautique française – fleurons de l’industrie européenne et piliers exportateurs exposés aux tarifs de Trump.
Il ne faut pas oublier la composante énergétique, alors que l’Europe souffre encore de la coupure de l’énergie russe. En substituant ce qui reste de son indépendance énergétique par l’importation des Etats-Unis, le bloc européen se prive d’une stratégie énergétique raisonnable. D’ores et déjà, 50% du gaz importé provient déjà des Etats-Unis. Et la dépendance technologique européenne ne fait que de s’accentuer face à la Chine et aux Etats-Unis.
Qualifier l’accord préliminaire de von der Leyen et de Trump de « réconciliation à sens unique » n’est donc pas seulement de la rhétorique. La zone euro affronte une croissance limitée à 0,7% en 2025, seuls quelques pays européens y échappent partiellement (la Suisse, le Danemark, l’Espagne et l’Italie dans une moindre mesure).
Cette crise économique s’inscrit dans un affaiblissement géopolitique de long terme de l’UE, fragilisant davantage son « modèle d’intégration » au profit d’Etats-nations économiquement plus résilients. Ce qui, dans le pire des scénarios, pourrait amorcer une dissolution progressive du projet européen collectif. Ainsi donc, la question se pose : le choix imposé par ce traité est-il neutre ?
Alignement énergétique, conformisme technologique, absence de taxation ambitieuse (équitable ?) … tout cela construit une dépendance européenne structurelle à l’économie américaine. Toutefois, face à cette menace, les voix se lèvent : certains appellent même au boycott des produits américains, même si les européistes se mobilisent pour modérer ce qu’ils appellent un « fantasme perfectionniste ». C’est à se demander si la seule volonté de Trump suffit à démanteler le tissu industriel européen, ou si la promesse de la stabilité immédiate mérite de condamner l’Europe à l’érosion économique.
Vers une crise existentielle de la zone euro ?
Selon le Conseil européen des relations étrangères (ECFR), les négociateurs européens auraient surestimé leur capacité à influencer l’administration Trump avec « de la bonne volonté et des concessions ciblées ». Cependant, même si l’accord venait à changer, la partie américaine n’est pas prédisposée à mettre en œuvre des mécanismes contraignants, ce qui signifie que Trump juge sa position déjà assez solide. En effet, et sans aucun effort, les Etats-Unis ont exploité les lignes de faille internes en Europe : l’Italie et la Pologne soutiennent l’accord. Alors que la France, l’Autriche, la Slovénie l’Allemagne (et éventuellement le Danemark) s’y opposent, pour le moment. L’image est celle d’une Europe fragmentée face aux Etats-Unis unifiés autour de leurs intérêts commerciaux, et une animosité cultivée pendant des années du côté américain.
Premièrement, la parité euro-dollar, aujourd’hui à 1,14, devrait s’effondrer d’ici fin 2025 selon les projections de plusieurs analystes, dont certains envisagent un retour à une parité 1 :1. Cela serait symptomatique d’un « euro trop fort » pour les économies européennes au bord de la récession, mais également des économies dépendantes en partie de l’Euro, comme celles de l’Afrique du nord et de la zone CFA.
Deuxièmement, Paris et Berlin n’ont aucune intention, encore moins la capacité, de faire face à ce courant. L’Allemagne affronte un effondrement de son modèle économique, historiquement bâti sur l’importation de gaz russe à bas prix. Le pays est aujourd’hui contraint d’importer du Gaz Naturel Liquéfié (GNL) américain trois fois plus cher, littéralement, ce qui plombe sa compétitivité industrielle. La preuve, l’industrie allemande perd du terrain sur les marchés mondiaux – comprendre, pas seulement le marché américain –, notamment en Asie et en Afrique. Quant à la France, le dilemme est existentiel : sauver la compétitivité de l’euro est incompatible avec la spirale de faillites, l’explosion de la dette et le chômage endémique de l’ère Macron.
Ainsi donc, face à cette situation, les partis d’extrême droite surfent sur la lassitude du public : le Rassemblement national (RN) en France évoque de plus en plus la sortie de l’euro ; en Allemagne, l’AfD multiplie les appels à quitter l’UE. C’est loin d’être surprenant, les partis réactionnaires arborent volontiers des propositions court-termistes. Ils sont loin d’en ignorer les conséquences pourtant. Une sortie précipitée de l’euro entraine systématiquement une crise de liquidité, une fuite massive des capitaux et des tension diplomatiques au sein du bloc européen. Pas comme si le Vieux continent n’avait pas déjà un passif de guerres fratricides qui marque son histoire – on ne mentionnera même pas les horreurs de la colonisation.
Pourtant, le débat mérite d’être taclé avec sérieux. En absence de réformes internes, notamment sur l’énergie, l’industrie, les nouvelles technologies et la dette, l’Europe se retrouvera piégée par ses choix passés : soumission commerciale aux Américains, dépendance énergétique, et modèles de production rigides. Face aux tentations de voir l’UE imploser, il est donc crucial que l’Europe révise sa stratégie macroéconomique. Autrement, les Etats européens risquent une sortie chaotique et non choisie, provoquée par un effondrement systémique.
L’Europe, otage consentant des Etats-Unis, face à sa dépendance chronique
Ursula von der Leyen s’est empressée d’accepter les conditions de Trump dans un espoir illusoire d’en atténuer les effets – dans un élan d’américanophilie également. Toutefois, le président américain a imposé ses conditions tarifaires aux Européens sans négociation réelle. Or, les dirigeants européens pensent composer avec un chef d’Etat américain raisonnable et dirigé par des usages républicains, rien n’est moins vrai. Comme le résume Al Jazeera, « les pays européens ont capitulé une fois, Trump reviendra pour en exiger plus ». Il serait objectif d’affirmer qu’au lieu de défendre ses intérêts (en tant que puissance mondiale), l’Europe s’est contentée de négocier le degré de sa soumission. Et dans le même temps, Trump continue de bloquer toute ouverture européenne vers la Chine, empêche les coopérations technologiques, fait pression pour restreindre les investissements de l’Europe dans le Sud global, et capitalise sur le gouffre qui sépare l’Europe d’un côté, et la Turquie et la Russie de l’autre.
Bref, l’ethnocentrisme historique européen persistant, qui a contribué (si ce n’est instigué) la diplomatie de bras de fer entre l’Occident et l’Orient, fait preuve de ses limites. Car depuis le début de la guerre en Ukraine, l’UE a reconfiguré sa diplomatie à marche forcée en suivant fidèlement les impulsions du complexe militaro-industriel américain. Ce choix, souvent présenté comme un alignement nécessaire sur « la démocratie » a finalement couté à l’Europe sa dernière marge de manœuvre pour réparer ses relations avec l’Afrique (néocolonialisme et seigneuriage monétaire) ou avec le Moyen-Orient (soutien du génocide israélien à Gaza). Qui sème le vent récolte la tempête ? La citation est biblique, mais là encore, l’Europe est désormais un continent cynique. En 2022, le blog catholique Le Salon beige déplorait « le suivisme fayoteur à l’égard de von der Leyen et Biden ».
Depuis des années déjà, les analystes de tous bords estiment que les BRICS+ s’imposent comme une alternative crédible à l’ordre international dominé par l’Occident, d’autant plus si ce dernier se fracture. Pendant que des puissances moyennes comme l’Arabie saoudite, l’Indonésie ou le Nigéria s’ouvrent à la Chine, à la Russie ou au Brésil, l’Europe peine à accepter son statut. L’Union européenne est restée figée dans une logique de « sanctions contre alignement » sans que pour autant aucune puissance émergente ne considère Bruxelles comme un partenaire stratégique du futur. L’Inde maintient ses distances, l’Amérique du sud voit l’Europe comme une extension atlantiste des Etats-Unis et l’Afrique dénonce les dictats postcoloniaux. A vrai dire, il ne reste que la zone MENA où l’Europe conserve encore un statut de hub diplomatique, par tradition, par pragmatisme ou par optimisme.
Il serait donc temps que quelqu’un dise ses quatre vérités aux Vieux continent. Car à trop suivre les humeurs américaines, l’UE a sacrifié sa cohérence interne, sa crédibilité diplomatique et son autonomie économique – même si cette dernière s’est bâtie sur le pillage des colonies. En résumé, l’Europe est à la croisée des chemins.
Pour éviter une fragmentation, voire le démantèlement, l’UE devra apprendre à dire non tout de suite (et non attendre la prochaine administration américaine), à construire des partenariats équilibrés avec le sud immédiat, et à établir une réelle souveraineté géopolitique. La servilité n’est pas une stratégie. Elle est, au mieux, une pause dans l’Histoire. Hélas, aujourd’hui, l’Histoire ne marque plus aucune pause.