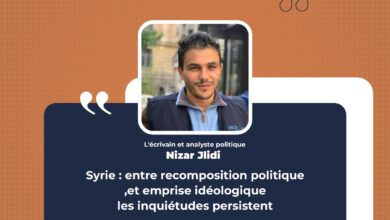Les banques commerciales sont-elles les ennemies des Tunisiens ?

Dans une Tunisie minée par l’inflation, le repli de l’investissement et le désengagement de l’État, un secteur se démarque par une constancequi interroge. Les banques commerciales,à rebours de tous les indicateurs économiques, affichent des bénéfices insolents. Un paradoxe apparent, qui cache une logique beaucoup plus politique.
Selon les derniers chiffres officiels publiés par la Bourse de Tunis, le résultat net global des sociétés cotées a progressé de 13,3 % en 2024, atteignant plus de 3 milliards de dinars. Mais cette croissance n’est pas uniforme, car près de 55 % de ce total est capté par le seul secteur bancaire, qui réalise à lui seul 1,7milliards de dinars de bénéfices, en hausse de 8,4%. Parmi les établissements les plus performants, la STB affiche une explosion de ses profits (une augmentation de 73%), suivie par la BNA (18,8%) et la BIAT (17,5%). Dans une économie en récession, où le pouvoir d’achat s’effondre et où l’investissement productif recule, ces chiffres sont pour le moins étranges. La question se pose alors avec une acuité croissante : comment les banques tunisiennes peuvent-elles prospérer dans un pays qui, lui, s’enfonce dans la crise ?
Les réponses proposées par les agences de notation elles-mêmes confirment le paradoxe. Dans une note publiée le 11 juillet, Fitch Ratings admet que les banques tunisiennes affichent une rentabilité record, malgré un environnement macroéconomique dégradé. Cette performance serait liée à la « résilience de la marge d’intermédiation », à la « gestion contenue des provisions » et à la concentration des portefeuilles sur des clients étatiques ou quasi étatiques. En d’autres termes : les banques tunisiennes ne gagnent pas leur argent en soutenant la relance économique, mais en renforçant leur position dans une économie fermée, protégée, et de plus en plus financiarisée.
Cependant, le cœur de cette rentabilité réside dans un mécanisme de rente – c’est indéniable. Les taux débiteurs appliqués aux clients, particuliers comme entreprises, restent parmi les plus élevés de la région, tandis que les taux créditeurs sur l’épargne sont décourageants. Le différentiel entre les deux (ladite marge d’intermédiation) permet aux banques de dégager des bénéfices importants sans prendre de risques majeurs.Cette stratégie est renforcée par la faible exposition au risque privé : les banques prêtent de plus en plus à l’Etat ou aux grandes entreprises publiques, captant ainsi une sécurité relative… au détriment de l’économie réelle.Car pendant que les banques engrangent des dividendes — 1,6milliards de dinars distribués en 2025, soit 13,4 % de plus que l’année précédente — le tissu productif s’effondre. Le crédit aux petites et moyennes entreprises (PME) reste marginal, l’accès au financement pour les jeunes entrepreneurs est inexistant !
La population active, elle, subit une triple peine : un crédit de plus en plus rare, des taux en hausse et un désengagement de l’Etat.
Le plus troublant dans cetteimage n’est pas tant la performance des banques que l’indifférencequ’elle suscite auprès des institutions de tutelle. Peu de débats parlementaires, aucune interpellation ministérielle, aucun signal de la Banque centrale n’est venu questionner la pertinence d’un système financier qui tourne sur lui-même pendant que le reste du pays vacille….
Sous le vernis, la complicité : Banque centrale, lois bancaires et dérives spéculatives
Face à une accumulation dangereuse des bénéfices bancaires, l’Etat tunisien réagit un peu tard :de nouvelles régulations ont été imposées en 2025 pour tenter d’encadrer la voracité d’un secteur devenu politiquement trop imposant. Toutefois, si certaines mesures ont symboliquement freiné l’élan spéculatif, elles n’ont en rien changé la logique d’ensemble. Les banques continuent de jouer sur deux tableaux : celui de la rentabilité immédiate, et celui de la captation institutionnelle. Pendant ce temps, l’économie continue de suffoquer et les banques ne sont pas inquiétées quant à leur rôle dans l’économie nationale. Pour rappel, durant le premier semestre de l’année 2025, la balance commerciale affiche un déséquilibre de plus de 1 milliard de dinars, et l’inflation a dépassé les 5,4%, selon l’Institut National de la Statistique (INS) qui, à son tour, se force à voir le verre à moitié plein.
Face à une crise sociale persistante et une pression inflationniste incontrôléeles autorités tunisiennes ont été contraintes de modifier en urgence certaines règles du jeu bancaire. Début 2025, plusieurs lois ont été votées pour imposer aux grandes banques une forme de contribution à l’effort national.Parmi les mesures phares : une réduction de 50% des taux d’intérêt appliqués à certains crédits à mensualités fixes, une obligation de consacrer 8% des bénéfices nets 2024 au financement direct des PME, et une hausse de la fiscalité sur les profits bancaires, portée à 40 %. Selon Fitch Ratings, ces décisions devaient entraîner une baisse moyenne de 11 à 14 % des bénéfices nets des dix plus grandes banques, soit un recul estimé à environ 170 millions de dinars pour l’exercice 2025. Reste à savoir si ces mesures ont été appliquées.
Quoi qu’il en soit,la baisse des bénéfices bancaires n’est qu’un ajustement. En réponse, les banques ont immédiatement réagi en interrompant tous les prêts à long terme, notamment dans le secteur immobilier. Selon les banques, ces engagements deviendraient non rentables avec les nouvelles contraintes. A partir d’avril 2025, plusieurs établissements ont ainsi suspendu les crédits supérieurs à 15 ans, bloquant brutalement l’accès au logement pour des dizaines de milliers de Tunisiens. Loin d’accepter leur nouveau rôle de levier économique, les banques se replient sur elles-mêmes, coupant la dynamique au lieu de la réorienter, et appliquant à leur tour une pression sur l’Etat.
La Banque centrale, quant à elle, s’est contentée d’observer ce bras de fer :aucun signal, aucune déclaration, aucune menace de sanction à l’encontre des établissements qui contournent la loi ou spéculent sur des secteurs sensibles n’a été émise. Les textes qui imposent un quota de financement au secteur privé sont systématiquement ignorés, sans la moindre conséquence. Et les holdings bancaires, engagées dans des activités spéculatives via des filiales cotées, poursuivent leurs investissements dans l’immobilier, les matières premières, et les ressources stratégiques — en contradiction formelle avec les obligations légales de séparation d’activité prévues par la Loi 48 du 11 juillet 2016 (article 47 et suivants).
Le silence institutionnel alimente une évidence : les banques tunisiennes sont devenues des acteurs politiques à part entière. Leur puissance financière leur confère une sorte d’immunité de fait, et leur influence sur les cercles de décision freine toute tentative de réforme structurelle. Même le Fonds monétaire international (FMI), pourtant prompt à conditionner ses aides à des engagements de transparence et de régulation, semble avoir abandonné la Tunisie à la logique des acteurs bancaires locaux, sans contrepartie ni exigence de réforme.
Là où l’État devrait imposer des lignes rouges, il négocie des zones grises. Et dans ces zones, les banques contournent la loi, voire l’ignorent. La Banque centrale se transforme en simple chambre d’enregistrement, etle ministère des Finances, lui, en gestionnaire passif de flux de trésorerie. Le tout pendant que les banques continuent d’engranger des bénéfices, de distribuer des dividendes (dont une grande partie est transférée vers l’étranger), et de redéployer leurs investissements vers des secteurs rentables (spéculation boursière, achat de devises, prêts étatiques) mais stériles pour l’économie réelle.
L’Etat peut, mais ne veut pas : comment briser le modèle bancaire ?
La Tunisie n’est pas une démocratie parlementaire fragmentée,elle n’est pas non plus une monarchie financière verrouillée. C’est un Etat-République centralisé, qui dispose de leviers de coercition puissants, surtout en plein état d’urgence. Et pourtant, face aux abus d’un secteur bancaireprédateur, la machine administrative reste tétanisée. Entre crainte politique, résignation technocratique et absence de conscience populaire, une question devient urgente : comment rompre avec ce modèle bancaire ? Car même dans les Républiques les plus solides, la tendance est à réguler la banque. Certains pays, comme les Etats-Unis, l’Italie ou le Brésil, sont allés jusqu’à détourner la prédation de leurs banques commerciales vers les pays étrangers, en contraignant sévèrement leur marge d’action nationale.
L’un des grands non-dits du débat public tunisien tient à l’influence structurelle des banques sur le pouvoir exécutif. Malgré leur faible capacité d’innovation, leur frilosité face au risque et leur concentration spéculative, ces institutions sont traitées avec une indulgence systémique. Pourquoi ? Parce qu’elles apparaissent comme les derniers bastions de stabilité financière dans une économie sans croissance. Parce qu’elles sont aussi, de plus en plus, adossées à des conglomérats internationaux, notamment français et marocains, qui disposent de relais diplomatiques puissants et discrets.Mais cette stabilité est une illusion. Une économie où les banques prospèrent alors que le reste du pays s’effondre est une économie en déséquilibre profond. Et ce déséquilibre n’est pas technique : il est politique. Car l’Etat tunisien dispose encore de moyens pour contraindre les banques à réintégrer leur rôle social, à commencer par la Banque centrale, et jusqu’à la Commission tunisienne des Analyses Financières (CTAF). Or, ces deux institutions sont en conflit, comme l’ont révélé des fuites de la réunion CTAF-GAFI fin mai –ce qui n’excuse en rien l’inaction sur le terrain légal.
En effet, par le droit, la législation tunisienne oblige les banques à consacrer une part de leurs bénéfices au financement du secteur privé de production. Ce taux est fixé par la réglementation bancaire, mais largement ignoré par la majorité des établissements. Aucun audit sérieux, aucune sanction, aucun retrait de licence n’a jamais été prononcé pour non-respect de ces obligations.
Ensuite, par l’exemplarité : les banques les plus rentables du pays sont celles qui disposent de holdings spéculatives, présentes en Bourse, dans l’immobilier, dans les matières premières. Cela leur permet de contourner leur fonction de crédit, en investissant dans des actifs peu risqués mais fortement rentables. Ce conflit d’intérêt flagrant est contraire à la loi tunisienne sur la séparation des activités bancaires et commerciales, mais là encore, les autorités ferment les yeux.
Enfin, par la volonté politique : aucune réforme n’est possible sans un signal venu d’en haut. La Banque centrale tunisienne pourrait imposer des quotas de financement aux PME, plafonner certaines marges, interdire certaines opérations spéculatives. Le ministère des Finances pourrait geler la distribution de dividendes en période de crise, ou lier les avantages fiscaux à des critères de soutien à l’économie réelle. Mais rien n’est fait,car personne ne veut heurter ce qu’il reste d’ordre financier.
Seulement voilà, cette résignation est dangereuse. Elle ressemble à de la complaisance et alimente le cynisme citoyen :pendant que les banques engrangent des milliards, les Tunisiens voient les prix flamber, les crédits inaccessibles, et les salaires bloqués (l’Etat est intervenu plusieurs fois pour dégeler les salaires du secteur public). Le sentiment d’injustice économique s’installe, se répand, se politise… ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’explose.
Faut-il alors rompre avec ce modèle bancaire ? Oui,pas de manière brutale ou populiste, mais méthodiquement : remettre la banque au service de l’économie, non l’inverse. Cela commence par la transparence, la répression des abus, l’incitation à l’investissement productif, la séparation des fonctions, et surtout : la restauration du rôle régulateur de l’Etat et l’application des lois !
Une nation peut survivre à la faillite, mais pas à l’injustice légalisée. La Tunisie ne peut pas être sous tutelle de ses bilans. Car le problème n’est pas que les banques soient trop puissantes, c’est que personne ne cherche vraiment à les contraindre.