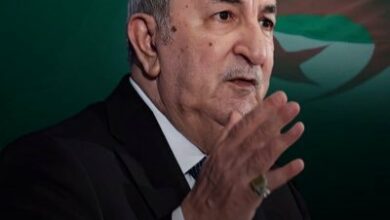Syrie : entre recomposition politique et emprise idéologique, les inquiétudes persistent

Alors que la Syrie semblait entrevoir une sortie de crise après la chute du régime de Bachar al-Assad, la phase de transition politique a rapidement révélé une réalité plus sombre.
Loin des espoirs de réconciliation et de reconstruction, le pays s’est enfoncé dans une spirale de violences confessionnelles, particulièrement dans les régions côtières, où des massacres de civils appartenant à la communauté alaouite ont été signalés au mois de mars.
Dans les premiers mois qui ont suivi la prise de contrôle de Damas par Hayat Tahrir al-Cham dirigée par Ahmad al-Shara, les signaux envoyés à la communauté internationale se voulaient rassurants. Un discours modéré a émergé, promettant des réformes en matière de droits des femmes et de reconnaissance des minorités religieuses.
La nomination d’une femme à la tête de la banque centrale syrienne avait été perçue comme un symbole fort, avant qu’elle ne soit abruptement démise de ses fonctions. Des consultations avec les communautés chrétienne, kurde et alaouite ont été engagées, dans une tentative de construire un dialogue national inclusif.
Une recomposition aux racines idéologiques troubles
Malgré cette façade, les inquiétudes se multiplient concernant la nature réelle du pouvoir en place. Hayat Tahrir al-Cham, longtemps perçue comme une excroissance de Jabhat al-Nosra, elle-même issue d’Al-Qaïda, cherche aujourd’hui à se présenter comme un acteur national légitime. Mais les fondements idéologiques du groupe demeurent problématiques.
Des experts rappellent que l’idéologie qui alimente Hayat Tahrir al-Cham puise largement dans celle des Frères musulmans. Selon le centre de recherche émirati Trends, cette mouvance a servi de matrice idéologique à plusieurs groupes islamistes violents à travers le monde. Inspirée notamment par les écrits de Sayyid Qutb, figure tutélaire de l’islamisme radical, cette idéologie repose sur un rejet des États-nations et une volonté d’établir un califat islamique au-delà des frontières.
La porosité entre l’idéologie des Frères musulmans et celle des groupes salafistes djihadistes rend floue la distinction entre les stratégies politiques de certains mouvements islamistes et les méthodes violentes des organisations terroristes. Cette convergence théorique alimente les craintes d’une mainmise durable de l’islamisme radical sur les structures de pouvoir syriennes.
Crise humanitaire et alerte internationale
Le basculement sécuritaire s’est accompagné d’un lourd tribut humain. L’Observatoire syrien des droits de l’Homme estime à plus de 2 000 le nombre de civils alaouites tués ou exécutés dans les régions côtières en mars dernier. Plus de 30 000 personnes ont fui vers le Liban voisin pour échapper aux violences, réveillant les spectres d’un nettoyage ethnique.
Face à cette situation, plusieurs capitales occidentales ont exprimé leur préoccupation. Berlin a exigé l’ouverture d’enquêtes sur les exactions, tandis que Paris a réclamé des sanctions ciblées contre les responsables. Une plainte a été déposée en France par le Collectif franco-alaouite, accusant Ahmad al-Sharaa et plusieurs membres de son gouvernement de crimes contre l’humanité, voire de génocide.
Le réalisme diplomatique à l’épreuve des principes
Malgré la gravité des accusations, certaines chancelleries semblent enclines à adopter une approche pragmatique. En janvier, les discussions autour d’un allègement progressif des sanctions à l’encontre de Damas ont débuté dans les cercles du G7 et du G20.
Emmanuel Macron est devenu le premier chef d’État européen à échanger directement avec Ahmad al-Sharaa, selon des sources rapportées par Le Monde.
Des rumeurs évoquent même une possible visite du nouveau dirigeant syrien à Paris information non confirmée, mais pas démentie non plus.
Cette posture française illustre les contradictions de certaines puissances occidentales, partagées entre la nécessité de contenir l’instabilité régionale et la réaffirmation de principes démocratiques. Elle survient par ailleurs dans un contexte où la France, à travers une enquête ouverte en 2024, cherche à mieux comprendre et freiner l’influence croissante des Frères musulmans sur son propre territoire.
Une vigilance accrue sur le front intérieur
En France, la question de l’influence idéologique des Frères musulmans ne se limite pas au dossier syrien. Le gouvernement a multiplié les mesures visant à contrer ce qu’il perçoit comme une menace à la laïcité républicaine.
L’expulsion de prédicateurs radicaux et l’interdiction de signes religieux ostensibles, comme l’abaya dans les établissements scolaires, s’inscrivent dans cette logique.
La sénatrice Nathalie Goulet, spécialiste de ces questions, a salué l’enquête comme une étape cruciale dans la lutte contre les ingérences idéologiques, soulignant que le laxisme antérieur a permis à des courants radicaux de s’enraciner dans le débat public français.
Entre duplicité et dépendance stratégique
L’évolution du dossier syrien met en lumière une tension persistante dans la politique étrangère de plusieurs pays européens. D’un côté, une vigilance renforcée à l’égard de l’islam politique sur le plan intérieur ; de l’autre, une ouverture diplomatique ambiguë envers des gouvernements liés, de près ou de loin, à cette mouvance.
Le Figaro a récemment dévoilé l’existence de financements européens directs ou indirects accordés à des structures associées à l’idéologie des Frères musulmans, alimentant une polémique sur la cohérence des choix stratégiques européens.
Le Institute for the Study of War avertit que tant que des groupes djihadistes continueront à jouer un rôle structurant dans le paysage syrien, aucune stabilité réelle ne pourra être atteinte. Pour les analystes, la domination actuelle de factions islamistes dans la Syrie post-Assad représente non pas une rupture, mais une continuité idéologique sous de nouveaux habits.