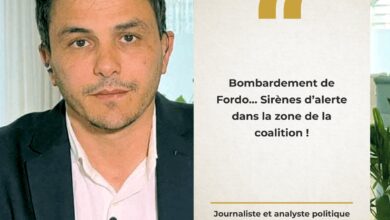Triptyque à Istanbul : Erdogan‑Meloni‑Dbeibah ou la nouvelle géopolitique méditerranéenne
Par: Nizar.jlidi

Au-delà de l’image, les intérêts. Vendredi,Triptyque à Istanbul : Erdogan‑Meloni‑Dbeibah ou la
nouvelle géopolitique méditerranéenne
Au-delà de l’image, les intérêts. Vendredi, Recep Tayyip Erdogan a reçu Giorgia Meloni et
Abdul‑Hamid Dbeibah dans le palais de Dolmabahçe, à Istanbul. À première vue, une réunion
discrète, entre alliés : migration, stabilité libyenne, coopération énergétique. Mais à y regarder de
près, elle réinvente les équilibres en Méditerranée centrale. Chaque acteur tire parti de la
rencontre tout en gardant ses marges d’autonomie.
Migration : coopération pragmatique ou verrou opportuniste ?
Meloni salue les « résultats excellents » de la coopération en matière de contrôle migratoire avec
Ankara, en suggérant que ce modèle pourrait servir pour renforcer la gestion libyenne des flux
vers l’Europe. Erdogan, quant à lui, plaide pour des « solutions durables à long terme », soulignant
la coordination multilatérale comme clé pour résoudre les crises à la source.
La situation est d’autant plus urgente que la Libye demeure un point de départ principal pour des
milliers de migrants : moins d’un an, déjà 21 000 arrivées en Italie, soit +80 % par rapport à 2024.
Ce contexte dramatique – tragédies en mer au large de Zuwara, notamment – met chacun des trois
pays sous pression.
Libye : entre diplomatie instrumentale et projections énergétiques
Le dossier libyen n’est jamais loin : Dbeibah incarne un attelage fragile issu d’un processus
morcelé au sein des Nations unies. Sarajevo d’unité fragile entre rivalités régionales soutenues
par la Turquie, l’Égypte, les Émirats, la Russie ou encore la France.
Erdogan a joué un rôle central depuis 2019‑2020, notamment avec l’accord maritime
Turquie‑Tripoli, très contesté par la Grèce et Chypre. En juin 2025, Ankara et Tripoli signaient un
accord pour des études géophysiques offshore sur 10 000 km, avec exploitation attendue dans les
neuf mois. Ce dispositif renforce le rôle de la Turquie dans l’exploration libyenne, tandis que
l’Italie demeure partenaire principal dans le transport du gaz via le gazoduc Greenstream vers la
Sicile.
Erdogan comme chef d’orchestre régional, entre Rome et Tripoli
Ankara endosse un rôle pivot qui dépasse l’islam politique : négociateur essentiel face à une
Union Européenne (UE) fragmentée. Partenaire – meilleur ennemi, vraiment – de Meloni sur la
défense (partenariat Leonardo‑Baykar, possible acquisition de Typhoons), Erdogan construit une
architecture stratégique répondant aux besoins italiens et libyens tout en consolidant son influence
régionale.
Meloni, à son tour, cherche à stabiliser les départs vers l’Europe, tout en sécurisant
l’approvisionnement énergétique de Rome. Elle affiche un nationalisme pragmatique :
coopération forte avec Ankara pour sauvegarder les intérêts italiens, y compris via Dbeibah.
Méditerranée : ce théâtre moins européen qu’on ne croit
Ce mini‑sommet illustre que la Méditerranée centrale ne se décrit plus seulement par l’UE. Elle
se joue dans des triangles flexibles, hors institutionnalisation. La commission européenne observe
sans dispositif intégré ; les formats ad hoc dictent désormais la gouvernance régionale. Istanbul
est ainsi un acte politique, une configuration pensée pour inscrire la Turquie comme pivot
méditerranéen.
Quand le réel dépasse les récits
Au-delà des titres convenus, cette rencontre du 1er août 2025 à Istanbul témoigne d’un
repositionnement stratégique : Meloni, Erdogan et Dbeibah signent l’acte d’un nouvel ordre
régional où les puissances moyennes se coordonnent indépendamment des dynamiques
européennes classiques. Pour qui observe en expert, la Méditerranée se redessine : elle
n’appartient plus à l’Europe centralisée, mais à des alliances pragmatiques et réactives.

Recep Tayyip Erdogan a reçu Giorgia Meloni et Abdul‑Hamid Dbeibah dans le palais de Dolmabahçe, à Istanbul. À première vue, une réunion discrète, entre alliés : migration, stabilité libyenne, coopération énergétique. Mais à y regarder de près, elle réinvente les équilibres en Méditerranée centrale. Chaque acteur tire parti de la rencontre tout en gardant ses marges d’autonomie.
Migration : coopération pragmatique ou verrou opportuniste ?
Meloni salue les « résultats excellents » de la coopération en matière de contrôle migratoire avec
Ankara, en suggérant que ce modèle pourrait servir pour renforcer la gestion libyenne des flux
vers l’Europe. Erdogan, quant à lui, plaide pour des « solutions durables à long terme », soulignant
la coordination multilatérale comme clé pour résoudre les crises à la source.
La situation est d’autant plus urgente que la Libye demeure un point de départ principal pour des
milliers de migrants : moins d’un an, déjà 21 000 arrivées en Italie, soit +80 % par rapport à 2024.
Ce contexte dramatique – tragédies en mer au large de Zuwara, notamment – met chacun des trois pays sous pression.
Libye : entre diplomatie instrumentale et projections énergétiques
Le dossier libyen n’est jamais loin : Dbeibah incarne un attelage fragile issu d’un processus morcelé au sein des Nations unies. Sarajevo d’unité fragile entre rivalités régionales soutenues par la Turquie, l’Égypte, les Émirats, la Russie ou encore la France.
Erdogan a joué un rôle central depuis 2019‑2020, notamment avec l’accord maritime Turquie‑Tripoli, très contesté par la Grèce et Chypre. En juin 2025, Ankara et Tripoli signaient un accord pour des études géophysiques offshore sur 10 000 km, avec exploitation attendue dans les neuf mois. Ce dispositif renforce le rôle de la Turquie dans l’exploration libyenne, tandis que l’Italie demeure partenaire principal dans le transport du gaz via le gazoduc Greenstream vers la Sicile.
Erdogan comme chef d’orchestre régional, entre Rome et Tripoli
Ankara endosse un rôle pivot qui dépasse l’islam politique : négociateur essentiel face à une Union Européenne (UE) fragmentée. Partenaire – meilleur ennemi, vraiment – de Meloni sur la défense (partenariat Leonardo‑Baykar, possible acquisition de Typhoons), Erdogan construit une architecture stratégique répondant aux besoins italiens et libyens tout en consolidant son influence régionale.
Meloni, à son tour, cherche à stabiliser les départs vers l’Europe, tout en sécurisant
l’approvisionnement énergétique de Rome. Elle affiche un nationalisme pragmatique :
coopération forte avec Ankara pour sauvegarder les intérêts italiens, y compris via Dbeibah.
Méditerranée : ce théâtre moins européen qu’on ne croit
Ce mini‑sommet illustre que la Méditerranée centrale ne se décrit plus seulement par l’UE. Ellese joue dans des triangles flexibles, hors institutionnalisation. La commission européenne observe sans dispositif intégré ; les formats ad hoc dictent désormais la gouvernance régionale. Istanbul est ainsi un acte politique, une configuration pensée pour inscrire la Turquie comme pivot méditerranéen.
Quand le réel dépasse les récits
Au-delà des titres convenus, cette rencontre du 1er août 2025 à Istanbul témoigne d’un
repositionnement stratégique : Meloni, Erdogan et Dbeibah signent l’acte d’un nouvel ordre régional où les puissances moyennes se coordonnent indépendamment des dynamiques
européennes classiques. Pour qui observe en expert, la Méditerranée se redessine :
elle n’appartient plus à l’Europe centralisée, mais à des alliances pragmatiques et réactives.