Le paradoxe américain ou les recettes de Monsieur Purgon.

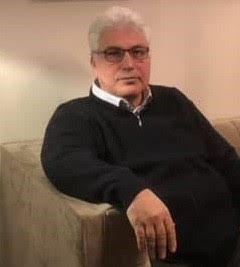
Par Jamel BENJEMIA
Il est des nations, comme des hommes, qui préfèrent les fables aux diagnostics, les fictions aux vérités. L’Amérique contemporaine, fière et vaine comme un personnage de Molière, se contemple dans le miroir déformant de ses propres illusions, parée des oripeaux du succès, alors même que son cœur économique bat à contretemps, dans une cadence déréglée. « The One Big Beautiful Bill Act » (« L’OBBB Act »), ultime scène grandiloquente d’un théâtre politique enfiévré, n’est pas une réforme : c’est une révérence, un simulacre d’ordre budgétaire.
Trump, qui revient tel Harpagon en campagne, ressuscite ses lubies fiscales dans un geste pavé de contradictions et de complaisances. Le 1er juillet 2025, le Sénat américain a adopté ce projet de loi monumental sous les airs d’une victoire solennelle. Deux jours plus tard, la Chambre des représentants a confirmé cette décision, avant que Donald Trump ne promulgue officiellement la loi le 4 juillet, jour symbolique de la fête nationale américaine. Mais derrière le rideau rouge et les feux de la rampe, c’est une pièce bien plus tragique qui se joue : celle d’un pays qui, à force de refuser la mesure, défie les lois de l’équilibre budgétaire comme on défierait les lois de la gravité, avec l’inconscience d’un enfant qui marche sur un fil sans filet.
Une ordonnance sans diagnostic
Car tout ici n’est que posture et imposture. « L’OBBB Act », malgré ses prétentions, n’est qu’un prolongement recyclé des baisses d’impôts du premier mandat Trump. Certains y voient une stratégie de croissance, mais il n’est au fond qu’un expédient, un leurre aux effets pervers, un geste politique qui, tout comme les prescriptions de Monsieur Purgon, soigne l’apparence du mal en l’exacerbant, insidieusement, dans le silence des organes. En d’autres termes, les baisses fiscales amplifient les déséquilibres qu’elles prétendent corriger.
Le déficit budgétaire atteint déjà 6,7 % du PIB, un chiffre effarant dans un cycle économique qui n’est pas encore franchement récessif. Et pourtant, loin de tenter un ajustement courageux, l’Amérique creuse le sillon d’une dette publique qui franchira bientôt, sans sursaut ni honte, les 106 % du PIB, seuil déjà atteint jadis, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le pauvre paie, le riche encaisse
Mais que l’on ne s’y trompe pas : le mal n’est pas uniquement arithmétique, il est moral et structurel. En réduisant la fiscalité des plus âgés, en restreignant « Medicaid » tout en octroyant des cadeaux fiscaux éphémères aux salariés sous forme d’exemptions anecdotiques, c’est tout un modèle social qui est dépecé au nom d’une logique de court terme.
Ce sont 12 millions de personnes supplémentaires qui se retrouvent sans assurance, si l’on cumule celles exclues de « Medicaid » et celles affectées par les modifications apportées à « l’Affordable Care Act ».
Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle trombe protectionniste, à la sauce Trump, s’annonce pour le 1er août 2025: une avalanche de droits de douane sur les importations, portée par un mercantilisme économique en quête de coup d’éclat. Ce ne sont plus seulement des taxes, ce sont des oriflammes de guerre commerciale, brandies comme des étendards électoraux.
Comme dans les comédies de Molière, où l’hypocrisie sociale se drape de vertus cardinales, « l’OBBB Act » feint la discipline alors qu’il organise la gabegie. C’est Tartuffe vêtu du drapeau étoilé, invoquant l’équilibre tout en priant les idoles de la dépense électorale.
Les républicains, sous couvert de réalisme fiscal, serrent la ceinture aux pauvres et délacent celle des nantis. L’économie propre est congédiée, les classes populaires sommées de justifier leur indigence par des heures de travail administrativement tortueuses, tandis que les grandes fortunes fossiles entrent en scène, saluées comme des sauveurs.
L’art de tourner le dos à demain
Et l’on s’étonne, peut-être, de cette vision à si courte vue. Mais c’est qu’il faut comprendre l’Amérique contemporaine comme un malade qui nie ses symptômes, un Diafoirus d’opérette, prescripteur bouffi de saignées et de lavements à un corps social déjà exsangue. La croissance à venir est invoquée comme un deus ex machina. On en attend des miracles fiscaux, une manne céleste qui comblerait les déficits sans réforme, une bénédiction keynésienne sans discipline ni sacrifice.
Ce mirage de croissance est d’autant plus fallacieux qu’il est brandi par ceux-là mêmes qui, hier, méprisaient l’État-providence. Désormais, ce sont les marchés qui doivent sauver l’Amérique, la bourse qui doit soutenir la dette, la consommation, en guise d’anxiolytique collectif, maintenant l’illusion d’une prospérité sous perfusion. Mais à mesure que l’inflation gronde et que les taux d’intérêt s’élèvent, c’est tout le château de cartes qui menace de s’effondrer.
L’Amérique, telle que l’exprime cette loi, souffre d’un vice plus profond : elle a perdu le sens du futur. Elle agit en somnambule, piétinant les lignes rouges de la soutenabilité sans même en prendre conscience. Son programme économique est une suite de gadgets fiscaux, où le crédit d’impôt pour les pourboires côtoie l’abandon de toute stratégie sérieuse de décarbonation. L’épopée technologique, l’intelligence artificielle, ces data centers gloutons en énergie… Tout cela exige une vision énergétique neuve, robuste, inventive. Et pourtant, l’administration américaine mise sur le charbon, le gaz de schiste, le passé comme avenir.
Ce n’est plus l’audace, mais la simplification du monde à coup de slogans, l’effacement de la complexité dans le confort de l’évidence… Voilà ce que produit l’esprit populiste lorsqu’il s’installe dans la durée.
L’austérité en différé
On se souvient des avertissements des grandes banques, des économistes, et des analystes : si les États-Unis poursuivent cette voie pendant dix ans, ils devront ensuite réduire leurs dépenses ou augmenter leurs impôts de 5,5 % du PIB, chaque année. C’est l’austérité grecque mais surdimensionnée, un traitement de choc pour un colosse aux pieds d’argile, qui se croit Hercule mais vacille déjà comme Argan, l’hypocondriaque de légende.
Et comme souvent chez Molière, le théâtre politique devient tragique quand il refuse la vérité. L’Amérique aujourd’hui est ce « Malade Imaginaire » qui convoque des experts à sa cheville pour mieux ignorer la gangrène dans son torse. Les comités parlementaires, les commissions sénatoriales, les économistes de cour, tous répètent les mêmes diagnostics, mais aucun ne parvient à réveiller la bête de son sommeil fiscal.
Et dans les coulisses, les véritables maîtres du jeu attendent. Les marchés obligataires, la finance mondiale, les agences de notation : voilà les spectateurs de demain, ceux dont l’indulgence, déjà, s’effrite. Car si la croissance promise ne vient pas, si les taux s’élèvent encore, si le dollar poursuit sa dépréciation, alors, la pièce tournera au drame. Le rêve fiscal deviendra cauchemar souverain. La dette, aujourd’hui invisible, se matérialisera en contraintes brutales.
Et l’Amérique, comme dans la dernière scène d’un Molière crépusculaire, découvrira que l’illusion ne peut éternellement tenir lieu de politique.
Puissance ou pantomime ?
Il n’est donc pas trop tôt pour relire nos classiques. Car enfin, quelle est cette puissance qui prétend incarner le progrès, tout en refusant les efforts nécessaires à sa pérennité ? Quelle est cette démocratie qui agite la bannière de la liberté tout en se liant aux logiques les plus archaïques de la rente fossile ? L’Amérique trumpiste, avec ses promesses d’aisance sans responsabilité, de gloire sans gravité, ressemble à s’y méprendre à un personnage de Molière : vaniteux, dispendieux, et farouchement attaché à son ignorance.
Et pourtant, c’est peut-être dans la fiction qu’il faut puiser la solution. Non pour s’en évader, mais pour y réfléchir. Car, comme le suggère Cléante dans Tartuffe, l’aveuglement volontaire est le plus grand des travers, ou, selon une sagesse arabe tout aussi acérée, « le dromadaire ne voit pas sa bosse ». C’est bien là le paradoxe américain : un empire lucide sur le monde, mais aveugle sur lui-même.
À force de jouer à la comédie, il se pourrait bien que l’Amérique, un jour, tombe le masque, et ne découvre dans le miroir que le vide laissé par ses propres fables.





